Si vous n'entendez pas l'hymne du pays cliquez sur un des drapeaux ou sur le bouton actualiser de votre navigateur

|
|

|
Généralités
| Nom officiel | République française |
| Continent | Europe (hémisphère nord) |
| Superficie | 550 000 km2 |
| Population | 58,6 million(s) d'habitants |
| Langue(s) officielle(s) | Français |
| Capitale | Paris |
| Régime politique | République |
| Chef de l'Etat | Jacques Chirac |
| Fête(s) nationale(s) | 14 juillet |
| Devise nationale | Liberté, égalité, fraternité |
| Monnaie nationale | Euro mais c'est le franc (1F=100 centimes) qui reste en circulation jusqu'en 2002 |
| PNB par habitant | 24 990 dollars par habitant |
| IDH [Indice de Développement Humain] (rang mondial) | 0,946 (2) |
| Budget de l'Etat | 54,1 % du PNB |
| Pays frontaliers | Espagne ; Italie ; Luxembourg ; Suisse ; Allemagne ; Belgique et de l'autre côté de la manche Royaume-Uni |
| Mers | Mer méditerranée, Manche et Océan Atlantique |
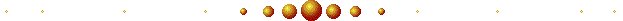
Géographie [Retour en haut de la page]
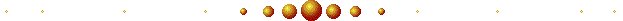
Présentation France, officiellement République française, pays d'Europe occidentale, bordé au nord par la Manche, le pas de Calais (qui la sépare de la Grande-Bretagne) et la mer du Nord ; au nord-est par la Belgique, le Luxembourg et l'Allemagne ; à l'est par l'Allemagne, la Suisse et l'Italie ; au sud-est par la mer Méditerranée ; au sud-ouest par l'Espagne et à l'ouest par l'océan Atlantique. La France a une forme presque hexagonale, avec une longueur nord-sud d'environ 965 km et une largeur maximale d'environ 935 km. Sa capitale et ville la plus importante est Paris. La République française comprend dix possessions d'outre-mer : les départements d'outre-mer (ou DOM) de la Guyane en Amérique du Sud, de la Martinique, de la Guadeloupe dans les Antilles et de la Réunion dans l'océan Indien ; les territoires d'outre-mer (ou TOM) de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie-Française, des îles Wallis-et-Futuna et des terres Australes et Antarctiques françaises (TAAF) ; les collectivités territoriales de Mayotte (statut de 1976) et de Saint-Pierre-et-Miquelon (statut de 1985). La superficie totale de la France métropolitaine est de 543 965 km2.
Relief La France occupe entre l'Atlantique et la Méditerranée un isthme étroit. C'est un pays d'altitude moyenne, dont les principales caractéristiques physiques sont des barrières montagneuses élevées au sud et à l'est, un ensemble de plateaux au centre et à l'extrême ouest, et de vastes régions de plaines et de collines s'étendant du nord au sud-ouest.
Un ensemble de chaînes montagneuses élevées allant des Alpes au Jura forme une frontière naturelle entre la France d'une part, l'Italie et la Suisse d'autre part.
Les Alpes comportent deux parties différentes : les Alpes du Nord, qui se divisent en quatre zones parallèles de l'est à l'ouest (les Préalpes, le Sillon subalpin, les hauts massifs alpins couverts de glaciers et la zone intra-alpine que découpe la frontière franco-italienne), sont traversées par de profondes et larges vallées qui facilitent les communications et la présence de villes ; les Alpes du sud, plus basses et plus arides offrent beaucoup d'obstacles à l'homme et sont moins propices à l'activité économique. Un grand nombre de sommets alpins culminent à plus de 4 000 m d'altitude ; le mont Blanc (4 807 m) est le plus haut sommet des Alpes et le premier sommet du continent européen.
Au nord du système alpin, le Jura oppose monts et plateaux. Sa partie orientale se caractérise par des plis serrés issus du mouvement alpin, tandis que sa partie occidentale est dominée par des plateaux ondulés. Le Jura a une hauteur maximale d'environ 1 718 m sur la frontière franco-suisse. Il marque la frontière est de la France, de l'extension orientale de la vallée du Rhône à la trouée de Belfort, la grande dépression qui fait le lien entre les bassins du Rhin et de la Saône. Du bord de la trouée de Belfort à l'angle nord-est de la France, la frontière franco-allemande est constituée par le Rhin. D'une altitude modeste, le massif hercynien des Vosges s'étend au nord de la trouée de Belfort et domine la région située entre la Moselle et le Rhin. Le point culminant des Vosges est le ballon de Guebwiller (1 423 m).
Entre l'Espagne et la France, la chaîne des Pyrénées présente une série de puissants escarpements et s'allonge sur 410 km de long, de l'Atlantique à la Méditerranée. Elle culmine dans les Pyrénées centrales avec des sommets dépassant 3 000 m d'altitude.
Le Massif central est séparé des ensembles montagneux de l'est par la vallée du Rhône et couvre près d'un sixième du territoire. Jadis constituée par des chaînes élevées, la région a été complètement rabotée par les périodes d'érosion qui se sont succédées dès le Primaire, puis soulevée au Tertiaire par le contrecoup des mouvements alpins. S'élevant progressivement à partir des plaines situées au nord et à l'ouest, le plateau est relevé à l'est et au sud. Il est caractérisé par de grands fossés longitudinaux dans la partie centrale, une région de volcans éteints prolongée au sud par les plateaux calcaires fortement érodés des Causses et par le rebord des Cévennes au sud-est, un ensemble de sommets s'élevant à partir des dépressions côtières méditerranéennes.
À la France alpine du sud et de l'est s'oppose la France des bassins et des socles usés du nord et de l'ouest. La région des plaines, la plus importante, est l'extrémité de la grande plaine d'Europe. À l'exception des collines rocheuses du Massif armoricain et des hauteurs des Ardennes, la France du nord et de l'ouest est constituée par des terres peu élevées qui ondulent à une hauteur moyenne de 200 m au-dessus du niveau de la mer. Au nord finit la grande plaine nord-européenne à laquelle succède le Bassin parisien entourant la vallée de la Seine et qui occupe la plus grande partie de la France septentrionale. Plus au sud, la vallée de la Loire s'étire entre les plateaux du Maine et les collines et vallées du Berry et du seuil Poitou-Vendée. Au sud-ouest enfin, le bassin dissymétrique d'Aquitaine descend des pentes du Massif central, tandis qu'il est dominé au sud par la chaîne des Pyrénées. L'ensemble de ces plaines est drainé par la Garonne et ses affluents. Cette commune disposition en bassins ou en gouttières a favorisé l'éclosion de villes-carrefours importantes qui jalonnent les vallées fertiles de la Seine, de la Loire et de la Garonne.
Hydrographie L'organisation du réseau hydrographique est commandée par l'agencement du relief. Autour du Massif central, les eaux se dispersent en quatre grands bassins : la Seine au nord, la Loire au nord ou est, le Rhône à l'est et la Garonne au sud-ouest. Avec leurs nombreux affluents, ces fleuves drainent les précipitations que l'Atlantique apporte sur la France. Le Rhône, fleuve puissant, est le plus important en terme de débit. Avec ses affluents, essentiellement la Saône, l'Isère et la Durance, il draine la région des Alpes françaises. L'Aube, la Marne, l'Oise et l'Yonne comptent parmi les principaux affluents de la Seine, qui est l'artère principale du système navigable à l'intérieur du pays. La France a peu de lacs et ceux-ci sont d'importance moyenne. Le lac Léman, à la frontière franco-suisse, est situé en majeure partie en Suisse.
Les côtes françaises, qui représentent environ 3 140 km de long, ont relativement peu de ports naturels ; leur aspect est imposé par le relief continental. Les côtes rectilignes du Nord, le long de la mer du Nord et de la Manche, sont constituées de grandes plages et de hautes falaises, qu'entrecoupent promontoires et estuaires. Les principaux ports de cette côte sont ceux de Dunkerque, Calais, Boulogne-sur-Mer, Dieppe, Le Havre et Cherbourg. Les côtes de la Bretagne, le long de la Manche et de l'Atlantique, sont très déchiquetées et abondent en îles, caps, baies et estuaires. Du sud de la Bretagne à la Gironde, la côte, basse et sablonneuse, a un dessin irrégulier rythmé par une succession de golfes et de caps. Au sud de la Gironde, elle est régulière et composée de plages sableuses, de dunes et d'étangs qui jouxtent les Landes. Les principaux ports de la façade atlantique sont ceux de Brest, Lorient, Saint-Nazaire et La Rochelle. Les ports de Nantes et de Bordeaux sont à l'intérieur, sur les estuaires de la Loire et de la Gironde. Les côtes méditerranéennes, qui font environ 620 km, sont alluviales et bordées d'étangs des Pyrénées au delta du Rhône, et rocheuses et accidentées du delta du Rhône à la frontière italienne. Les ports principaux sont Marseille, Toulon et Nice.
Climats Le climat de la France est généralement tempéré, bien qu'on observe de forts contrastes régionaux : dans la région côtière méditerranéenne alternent étés secs et chauds et hivers doux, tandis qu'un climat à tendance continentale domine sur le plateau central et dans les montagnes de l'est. Le climat océanique, caractéristique de la Bretagne et de la Normandie, s'étend d'une façon générale à tout l'ouest de la France. Les contrastes thermiques y sont peu accusés et les températures sont nivelées par les courants océaniques et les vents dominants de secteur ouest. L'est de la France subit, par le relais de l'Europe centrale, des hivers froids et des étés lourds, accompagnés d'orages. Zone de transition entre influence océanique et influence continentale, Paris a une température moyenne de 3,2°C en janvier et de 19,5°C en juillet. À Strasbourg, on passe d'une température moyenne de 0,8°C en janvier à une moyenne de 19,1°C en juillet et Nice a une température moyenne de 8,3°C en janvier et de 22,4°C en juillet. Les précipitations, abondantes toute l'année à l'ouest, augmentent avec l'altitude à l'est et sont fréquentes sous forme d'averses en automne et au printemps dans le sud. Les moyennes annuelles sont de 585 mm à Paris et de 813 mm à Lyon. De grands écarts de précipitations peuvent être observés selon les régions : de l'ordre de 1 397 mm par an dans les régions montagneuses, elles ne sont que de 254 mm annuels dans certaines plaines du Nord. Une des particularités météorologiques du sud de la France est la présence de mistral, un vent du nord violent originaire du plateau central, qui souffle dans la région méditerranéenne.
Flore et faune Les plantes et les arbres de France, qui reflètent la variété caractéristique de l'Europe continentale, vont des lichens et des mousses de type arctique et alpin à des espèces semi-tropicales comme les oliviers et les orangers. On trouve dans les forêts des espèces variées de conifères et d'arbres à feuilles caduques, ces forêts couvrant environ 14,7 millions d'hectares, soit près de 27 p. 100 de la superficie du pays. Les plaines de l'est sont souvent boisées et la façade maritime sud-ouest est occupée par une vaste lande forestière artificielle. Les principaux arbres sont les hêtres, les chênes et chênes-lièges, les charmes, les châtaigniers et les noyers. Les sapins et les épicéas se localisent sur les versants des moyennes montagnes. Les vignobles et les arbres fruitiers s'étagent sur les versants bien exposés. La végétation du Sud Méditerranéen, adaptée aux conditions de sécheresse, est constituée par les forêts de chênes verts et de pins. Maquis et garrigues se partagent les sols siliceux et les sols calcaires.
Comme dans le reste de l'Europe occidentale, la faune de France compte peu de représentants des grands mammifères ; les plus communs sont le cerf, le daim et le chevreuil. On rencontre également des chamois dans les hautes régions des Alpes et quelques sangliers survivent dans les forêts reculées. Parmi les dizaines d'espèces d'animaux plus petits, on trouve des hérissons, des lièvres et des lapins et plusieurs carnivores de la famille des belettes. Les oiseaux sont variés et nombreux, avec à la fois des espèces résidentes et des migrateurs. Les reptiles sont assez rares et les seuls venimeux en France sont les vipères. La carpe, la truite et le brochet sont les poissons d'eau douce les plus courants. Les eaux côtières de l'Atlantique et de la Méditerranée recèlent de très nombreuses espèces de poissons : morue, hareng, merlan, maquereau, flétan, sardine, thon, dorade, sole, etc.
Démographie La population de la France était estimée à 58 millions d'habitants en 1995, soit une densité moyenne de 106 habitants au kilomètre carré, beaucoup plus faible que celle de ses voisins européens : la densité au kilomètre carré atteint 229 habitants en Allemagne, 236 au Royaume-Uni et 442 aux Pays-Bas. En revanche, le taux de fécondité est aujourd'hui stabilisé à 1,8 enfant par femme en âge de procréer, un chiffre trop faible pour assurer le renouvellement des générations (2,1 enfants par femme) mais néanmoins supérieur au taux européen moyen. L'accroissement annuel y est actuellement de 350 000 habitants supplémentaires par an, soit 0,6 p. 100. Grâce à la qualité de l'encadrement médical, le taux de mortalité infantile (7,2 p. 1 000 en 1990) est un des plus faibles du monde. L'espérance de vie moyenne ne cesse de croître et atteignait 81,9 ans pour les femmes et 73,8 ans pour les hommes en 1995 (au lieu de 75,8 et 68,4 en 1970). La structure démographique de la France révèle un vieillissement continu de la population, la part des moins de vingt ans étant passée de 30,7 p. 100 en 1979 à 26 p. 100 en 1995, tandis que celle des plus de 65 ans est passée au cours de la même période de 13,9 p. 100 à plus de 15 p. 100.
En réalité, la France, qui occupe le 18e rang des États du monde pour la population, a entamé très précocement sa transition démographique (v. 1800 et même avant). Seul le sursaut du «baby-boom» après 1945 a mis provisoirement fin à la stagnation démographique, mais la France, parallèlement aux autres nations industrialisées, a connu dès le milieu des années 1960 un ralentissement de son taux de natalité. Aujourd'hui, grâce à un taux de natalité stabilisé et en raison d'une immigration étrangère qui est restée importante malgré les restrictions imposées depuis 1975, la France poursuit une timide croissance démographique, insuffisante cependant pour remettre en cause le vieillissement accéléré de sa population.
Environ 75 p. 100 des Français résident dans une agglomération urbaine de plus de 2 000 habitants. Quatre régions monopolisent 43 p. 100 de la population sur 18 p. 100 du territoire national : l'Île-de-France, la région Rhône-Alpes, la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et le Nord-Pas-de-Calais. En revanche, les très grandes villes ont perdu une partie de leur population entre 1975 et 1990. Paris détient le record du déficit migratoire, ayant perdu près d'un tiers de sa population depuis 1945. Mais, si la population des grandes villes diminue, c'est surtout au profit de banlieues tentaculaires qui ne cessent de s'étendre de plus en plus loin, alors même que la périurbanisation (implantation de citadins hors des limites reconnues des agglomérations) est en progression. Un tiers seulement des départements a une densité supérieure à la moyenne, tandis qu'un autre tiers, le «désert français», a une densité inférieure à 50 habitants au kilomètre carré. Les recensements de 1982 et 1990 ont montré que la population se déplace en circuit fermé à l'intérieur de l'Hexagone, et décrit un mouvement du nord vers le sud.
Il est impossible de connaître exactement le nombre d'étrangers réellement présents sur le territoire en raison des difficultés de recensement et de l'immigration clandestine. Selon le ministère de l'Intérieur, la France comptait 4,5 millions d'étrangers vivant sur son sol en 1990, soit 7,75 p. 100 de la population totale (alors que seulement 1,5 million de Français vivent à l'étranger). La plus importante communauté étrangère est constituée par les Portugais, au nombre de 649 714, mais ce sont les Maghrébins (Algériens, Marocains et Tunisiens) qui constituent le groupe le plus nombreux : de 1960 à 1990, ils sont passés de 20 à 55 p. 100 du total de la population étrangère. Viennent ensuite les Européens, les ressortissants d'Afrique noire, les Asiatiques et les ressortissants de pays d'Europe de l'Est, en constante augmentation. Les naturalisations sont également en augmentation (3,1 p. 100 de Français par acquisition en 1990). Les immigrés sont moins nombreux dans la partie ouest de la France et sont surtout concentrés dans les grandes agglomérations urbaines.
Divisions administratives La France métropolitaine est composée de 22 régions, qui sont subdivisées en 96 départements et 3 808 cantons. Ces régions sont : l'Alsace, l'Aquitaine, l'Auvergne, la Basse-Normandie, la Bourgogne, la Bretagne, la région Centre, la région Champagne-Ardenne, la Corse, la Franche-Comté, la Haute-Normandie, l'Île-de-France, le Languedoc-Roussillon, le Limousin, la Lorraine, la région Midi-Pyrénées, le Nord-Pas-de-Calais, les Pays-de-la-Loire, la Picardie, la région Poitou-Charentes, la région Provence-Alpes-Côte d'Azur (PACA) et la région Rhône-Alpes.
Les possessions françaises outre-mer comprennent quatre départements d'outre-mer (DOM), la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane et la Réunion, dont chacun constitue également une région mono-départementale, ainsi que trois territoires d'outre-mer (TOM), la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie-Française, Wallis-et-Futuna, dont chacun a été pourvu d'un statut particulier par la loi. Ainsi, la Polynésie française est administrée par un gouvernement, qui émane lui-même de l'assemblée territoriale élue tous les cinq ans dans le cadre de cinq circonscriptions ; le territoire élit deux députés et un sénateur, et les intérêts de la République sont représentés par un Haut-commissaire. En Nouvelle-Calédonie, le pouvoir exécutif est exercé par un Haut-commissaire nommé par le gouvernement, assisté des trois présidents des Assemblées de province et du président du Congrès territorial qui regroupe les membres des Assemblées des Provinces. Le Territoire élit également deux députés et un sénateur. Enfin, le territoire de Wallis-et-Futuna, qui élit un député et un sénateur, est administré par un administrateur supérieur qui représente l'État ; il est assisté par un Conseil territorial dont les attributions sont essentiellement consultatives. Collectivités territoriales à statut particulier, Saint-Pierre-et-Miquelon et Mayotte, qui élisent chacun un sénateur et un député, possèdent toutes deux un conseil général, l'État étant représenté dans ces territoires par un préfet.
Villes principales La capitale et la plus grande ville de France est Paris, qui avait en 1990 une population de 2 152 423 habitants (aujourd'hui moins de 2 millions), 9 320 000 avec l'agglomération. Les autres villes importantes sont Marseille (800 550 habitants intra-muros, 1 087 376 dans l'agglomération Marseille-Aix-en-Provence) et Lyon (415 487 habitants intra-muros, 1 262 223 dans l'agglomération). Viennent ensuite par ordre décroissant Toulouse (358 688 habitants intra-muros, 608 430 dans l'agglomération), Nice (342 439 habitants intra-muros, 475 507 dans l'agglomération), Strasbourg (252 338 habitants intra-muros, 388 483 dans l'agglomération), Nantes (244 995 habitants intra-muros, 492 255 dans l'agglomération), Bordeaux (213 336 habitants intra-muros, 685 456 dans l'agglomération), Montpellier (207 996 habitants intra-muros, 236 788 dans l'agglomération), Rennes (203 533 habitants intra-muros, 245 065 dans l'agglomération), Saint-Étienne (201 569 habitants intra-muros, 313 338 dans l'agglomération), Le Havre (195 854 habitants intra-muros, 253 627 dans l'agglomération) et Lille (172 142 habitants intra-muros mais quatrième agglomération de France avec 950 265 habitants dans l'ensemble Lille-Roubaix-Tourcoing). En 1990, plus de 20 autres villes françaises avaient des populations supérieures à 100 000 habitants.
Religions Le catholicisme est la religion de 75 p. 100 des Français, peu pratiquants mais encore très nombreux à se dire catholiques et à faire baptiser leurs enfants. En raison de la forte immigration issue du Maghreb, l'islam est aujourd'hui devenu la seconde religion de France et compte plusieurs millions d'adeptes. Le protestantisme et le judaïsme, qui connaît un renouveau religieux au sein de l'importante communauté juive française, viennent ensuite. Jusqu'à la fin du XIXe siècle, les cultes étaient financés par l'État. En 1905, la législation française a mis fin au Concordat de 1801, excepté dans la région Alsace et en Moselle où il est toujours en vigueur. Avec cette mesure, le gouvernement français supprima toute reconnaissance officielle des cultes religieux. La gestion des relations avec les cultes incombe aujourd'hui au ministère de l'Intérieur.
Langues Le français, langue officielle, est parlé par une très grande majorité des personnes vivant en France et on compte quelque 122 millions de francophones dans le monde. De nombreuses langues régionales subsistent et sont même, pour certaines d'entre elles, enseignées dans les écoles et à l'université. On parle ainsi le breton en Bretagne, le basque et le catalan sont parlés dans les Pyrénées, le corse, proche de l'italien, en Corse, l'occitan dans certaines zones du midi méditerranéen, et le flamand est parlé dans les Flandres. L'alsacien, un dialecte allemand, est parlé en Alsace.
Système scolaire Les centres d'enseignement en France, des universités françaises du Moyen Âge - dont l'université de Paris fondée au XIIe siècle -, aux universités modernes et aux grandes écoles, ont servi de modèle dans de nombreux pays du monde.
La centralisation de l'administration scolaire a connu une accélération décisive sous le règne de Napoléon entre 1806 et 1808. Le système éducatif moderne est fondé sur les lois votées à partir de 1880 sous l'influence de Jules Ferry, ministre de l'Instruction publique. Ces lois ont institué l'éducation publique, laïque, gratuite et obligatoire, sous le contrôle de l'État. Des modifications ultérieures ont défini le régime de l'enseignement gratuit dans le secondaire et les collèges techniques, la séparation de l'Église et de l'État dans l'éducation en 1905, les lois d'aide aux écoles privées sous contrat, y compris les écoles confessionnelles, en 1951 (loi Baranger) et 1959 (loi Debré), l'extension de la scolarité obligatoire jusqu'à seize ans en 1959.
Pour répondre aux revendications étudiantes de mai 1968, des réformes universitaires furent mises en place par le ministre de l'Éducation, Edgar Faure. Le nouveau système enleva au ministère de l'Éducation le contrôle des budgets et le suivi des carrières des enseignants à l'échelon national. À la place, on institua des unités d'enseignement à différents niveaux, on conféra aux facultés une autonomie de recrutement et on donna aux étudiants un rôle plus important dans la vie de l'université. Plusieurs universités importantes furent restructurées en unités plus petites et le nombre d'universités françaises augmenta de 23 à environ 70 dans les années 1980. En 1985, le gouvernement de Laurent Fabius donna à l'Éducation nationale l'objectif de faire parvenir au niveau du baccalauréat 80 p. 100 des jeunes d'une même classe d'âge dans les dix ans à venir. D'ambitieux programmes de développement et de démocratisation de l'enseignement supérieur furent ensuite votés, dont le plan «Universités 2000». Avec un budget de plus de 351 milliards de francs de crédits en 1994, le budget de l'Éducation nationale et des universités est le premier poste de dépenses de l'État. En 1989, cependant, près de 2 200 000 Français avaient encore des difficultés à maîtriser l'écriture et la lecture, soit 6,3 p. 100 des adultes.
Bibliothèque et musées La plupart des villes de province ont des bibliothèques municipales et des musées. C'est à Paris cependant que l'on en trouve la plus grande concentration. La Bibliothèque nationale de France, la plus importante de Paris avec plus de 9 millions de volumes, est en cours de transfert sur le site de Tolbiac au bord de la Seine. Le Louvre contient l'une des collections d'art les plus importantes au monde, tandis que le musée d'Orsay est consacré à l'art du XIXe siècle. Autre musée parisien, le Centre national d'art et de culture Georges-Pompidou possède également des collections majeures, notamment en peinture et en design du XXe siècle, et est le monument le plus visité de France.
Les villes de Nice et de Grenoble possèdent d'importants musées d'art moderne et de nombreuses fondations dues à l'initiative d'opérateurs privés existent dans toute la France. Un grand nombre d'églises et de châteaux, classés monuments historiques, sont placés sous le contrôle de la Direction du patrimoine du ministère de la Culture et bénéficient de subventions pour leur restauration et leur entretien.
Communications et médias En France, le système des postes et des télécommunications est placé sous le contrôle de l'État, mais France Télécom devrait être privatisée d'ici l'an 2000. Plus de 33,3 millions de postes téléphoniques étaient en service en 1993. La France compte quelques grands groupes de communication d'importance mondiale comme Havas (3,7 milliards de chiffre d'affaires en 1994) et Matra-Hachette. Les services de radio et de télévision sont à la fois publics et privés. En 1995, la France comptait quatre chaînes de télévision publiques (France 2, France 3, la Cinquième et Arte), deux chaînes hertziennes privées (TF1, premier opérateur privé européen en termes de chiffre d'affaires, et M6), une chaîne privée à péage (Canal Plus) ainsi que de nombreuses chaînes câblées et par satellites. Plus de 96 p. 100 des Français sont équipés d'une radio et d'une télévision et près de 50 p. 100 d'un magnétoscope.
En 1990, la France avait 79 quotidiens ayant une diffusion totale de plus de 9,4 millions. D'après les chiffres de la Fédération internationale des journaux, la France a vu sa presse quotidienne accuser un recul de sa diffusion de 1,5 p. 100 en 1994 et se situe au 37e rang mondial pour la consommation de presse quotidienne. À l'inverse, elle compte parmi les tout premiers pays mondiaux pour la production et la consommation de magazines. Les quotidiens les plus influents sont publiés à Paris, notamment Le Figaro (465 500) et Le Monde (diffusion 445 000). Parmi les principaux périodiques, on peut citer Paris-Match (diffusion 690 000), L'Express (490 000), Le Canard Enchaîné (450 000), Elle (395 000) et Le Nouvel Observateur (380 200).
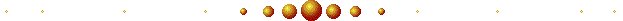
Economie et vie politique [Retour en haut de la page]
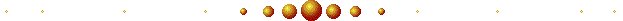
Gouvernement La France est une république ; son régime, semi-présidentiel, est régi par la Constitution d'octobre 1958. Ce texte réduit les possibilités pour le Parlement de renverser le gouvernement, renforçant la stabilité ministérielle en développant les mécanismes du parlementarisme rationalisé (article 49.3, possibilité pour le gouvernement de prendre des mesures législatives par ordonnances). Parallèlement, la Constitution renforce l'autorité et les pouvoirs du président, qui se réserve un droit de regard privilégié sur la politique étrangère et la politique de défense (domaine réservé).
Investi de la souveraineté, le peuple français exerce son pouvoir à travers les élections législatives, présidentielles et lors des consultations par référendum. Le Parlement se compose de l'Assemblée nationale (577 députés, élus pour cinq ans) et du Sénat (321 membres, élus pour neuf ans), qui peuvent être réunis en Congrès pour opérer une révision de la Constitution. L'Assemblée nationale est élue au suffrage universel direct, au scrutin majoritaire d'arrondissement à deux tours. L'Assemblée est l'expression directe de la souveraineté populaire et, investie de la mission de voter la loi, peut mettre en jeu la responsabilité du gouvernement. Les sénateurs sont élus au suffrage indirect, par un collège électoral composé des députés, des conseillers généraux, des conseillers régionaux et de délégués des conseils municipaux. Par son mode d'élection, le Sénat tend à accorder une représentation importante aux régions rurales et aux villes moyennes, ainsi qu'aux Français de l'étranger. La Constitution de 1958 a créé un nouvel organe, le Conseil constitutionnel, autorité indépendante qui a tout pouvoir pour superviser les élections et les référendums et qui juge de la conformité de la loi à la Constitution et au bloc de constitutionnalité incluant les grandes lois de la République depuis 1789 ; le Conseil comprend neuf membres nommés pour neuf ans par le président de la République et les présidents des deux assemblées. Les anciens présidents de la République en sont membres de droit. Le droit de vote est fixé à dix-huit ans en France.
Le pourvoir exécutif Le président de la République est élu pour sept ans au suffrage universel direct. Son mandat est renouvelable et il dispose du droit de dissoudre l'Assemblée nationale après consultation des présidents des deux assemblées parlementaires. Le président est le chef des armées et préside le Conseil supérieur de la magistrature, le Comité de défense nationale et le Conseil des ministres. Le président désigne le Premier ministre et nomme les ministres en accord avec ce dernier. En cas de vacance ou de décès, la fonction présidentielle est provisoirement exercée par le président du Sénat.
Le Premier ministre et le Conseil des ministres sont responsables uniquement devant l'Assemblée nationale, bien que le Premier ministre ait la possibilité de demander au Sénat d'approuver une déclaration de politique générale. En pratique, le Premier ministre est également placé sous l'autorité du président de la République, qui peut lui demander sa démission en cas de désaccord sur la politique gouvernementale (sauf en cas de cohabitation au sommet de l'État d'un président de la République et d'un Premier ministre de tendances politiques différentes). Le Premier ministre est le responsable de la mise en œuvre de la politique gouvernementale et intervient également à ce titre dans les domaines de la défense et des affaires étrangères. Lorsque l'Assemblée nationale adopte une motion de censure, ou lorsqu'elle rejette le programme ou une déclaration de politique générale, le Premier ministre doit présenter la démission de son gouvernement.
Le pouvoir législatif Le Parlement français est constitué de deux Chambres, l'autorité législative suprême appartenant à l'Assemblée nationale. Le Sénat a un vrai rôle législatif et peut retarder, à défaut de pouvoir les empêcher, l'adoption des lois : si les deux Chambres sont en désaccord à propos d'une loi, la décision finale dépend de l'Assemblée nationale après deux tours de «navette», et peut, ou bien accepter les amendements du Sénat, ou bien faire passer son propre texte. La Constitution de 1958, qui prévoyait pour les assemblées deux sessions annuelles d'une durée totale de cinq mois et demi, a été révisée en 1995 pour permettre la tenue d'une session unique de neuf mois. La responsabilité du gouvernement peut être mise en jeu par le dépôt d'une motion de censure, qui n'est considérée comme adoptée que si elle a recueilli la majorité absolue (au lieu de la majorité des votants comme auparavant). La Constitution interdit par ailleurs à ceux qui ont présenté une motion de censure repoussée de présenter une autre motion de censure au cours de la même session. À la différence des Constitutions précédentes, les ministres ne peuvent simultanément occuper une fonction parlementaire et divers dispositifs tendent à limiter le cumul des mandats. Les amendements constitutionnels peuvent être adoptés après approbation des deux Chambres et un référendum populaire, ou par la simple approbation des trois cinquièmes du Parlement réuni en Congrès à Versailles.
Autres organes prévus par la constitution Le Conseil économique et social, composé de personnalités choisies en raison de leurs compétences, de représentants des salariés, des employeurs et des organismes professionnels et culturels, joue un rôle consultatif auprès de l'Assemblée nationale et du Conseil des ministres. Le Conseil d'État assiste le gouvernement dans l'élaboration des textes de loi et vérifie la conformité des règlements aux principes du droit administratif et à la Constitution.
Partis politiques La France a été longtemps caractérisée par une très grande atomisation des partis politiques, dont beaucoup, à l'image du parti radical, constituaient des partis de notables. Les règles institutionnelles de la Ve République ont cependant obligé les petites formations à fusionner, favorisant une bipolarisation durable de la vie politique. Quatre partis principaux, deux de centre droite et deux de gauche, ont dominé la politique française depuis 1958. Le Rassemblement pour la République ou RPR, fondé en 1976 par l'actuel président de la République Jacques Chirac et dirigé par Alain Juppé, se présente comme l'héritier du mouvement gaulliste. L'Union pour la démocratie française (UDF), fédération bâtie autour du Parti républicain et dont l'autre composante principale est représentée par les centristes de Force démocrate, a longtemps été liée à l'ancien président de la République Valéry Giscard d'Estaing qui l'a fondée en 1978 et en a quitté la présidence en 1996 au profit de François Léotard. À gauche, on trouve le Parti socialiste, qui fut dirigé par François Mitterrand jusqu'en 1981 et est aujourd'hui sous la responsabilité de Lionel Jospin, le Parti communiste français, dirigé par Georges Marchais puis par Robert Hue. À ces quatre partis qui forment l'ossature du Parlement et de la vie politique sous la Ve République il faut ajouter le Front national de Jean-Marie Le Pen, parti proche de l'extrême droite qui a connu une importante croissance électorale au cours des années 1980 et 1990, les différents mouvements écologistes (partis verts), les radicaux de gauche et l'extrême gauche dont le représentant principal est l'organisation Lutte ouvrière d'Arlette Laguillier, qui a obtenu 5,3 p. 100 des voix à la dernière élection présidentielle. De plus en plus, la France tend à être gouvernée au centre, mais sa vie politique reste dominée par deux grands blocs droite/gauche qui alternent au pouvoir depuis 1981.
Administratiosn locales et départemantale Les 96 départements métropolitains sont répartis en 21 régions et une collectivité territoriale à statut particulier (la Corse). En 1981, le gouvernement du président Mitterrand introduisit la décentralisation, créant des conseils régionaux aux compétences élargies. Dans chaque région, les conseillers régionaux élisent un exécutif régional présidé par un président de région. Les départements sont divisés en cantons, qui élisent les conseillers généraux, et en plus de 36 000 communes, qui sont dirigées par des conseils municipaux de 10 à 36 membres, élus pour un mandat de cinq ans. Chaque conseil municipal élit un maire. Dans chaque département, un préfet, nommé en Conseil des ministres, représente l'État. Il existe également des préfets de région.
Le système judiciaire Pour les délits mineurs et les affaires civiles, la justice est rendue par les tribunaux d'instance (au nombre de 473) et les tribunaux de grande instance (au nombre de 181). Les crimes punissables de cinq ans de prison sont jugés par les tribunaux correctionnels. Les cours d'appel (au nombre de 35) jugent en deuxième instance les affaires traitées par ces tribunaux. Les affaires criminelles importantes sont jugées devant des cours d'assises (au nombre de 102). Les décisions des cours d'assises et des cours d'appel ne peuvent être révisées que par la Cour de cassation, la plus haute instance juridictionnelle, qui peut annuler des jugements et les renvoyer devant une autre juridiction pour vice de forme, sans se prononcer sur le fond de l'affaire. Ses décisions font jurisprudence et donnent l'orientation du droit français sur telle ou telle question. Des juridictions spécialisées traitent des litiges commerciaux (tribunaux de commerce, au nombre de 230), des conflits entre employés et employeurs (conseils de prud'hommes, au nombre de 289), des contentieux relatifs à la Sécurité sociale (tribunaux des affaires de Sécurité sociale au nombre de 110). Les magistrats se répartissent entre représentants du siège (tribunaux) et représentants du parquet (ministère public). Les tribunaux administratifs (au nombre de 33) et les cours administratives d'appel jugent des affaires relatives au droit administratif et peuvent être saisis par les particuliers.
Défense Le service national d'une durée de dix mois est obligatoire pour les hommes de 18 à 35 ans. Un projet du gouvernement, rendu public dans un discours de Jacques Chirac le 22 février 1996, a proposé la suppression graduelle de la conscription, qui serait remplacée par un volontariat et une très courte période de formation civique et civile ; la totalité des missions de défense reviendrait à une armée de métier. Désormais les jeunes âgés de 18 ans sont appelés sous les drapeaux lors de la journée d’appel à la défense.
Le budget de la défense était de 241,4 milliards de francs en 1992, soit 3,4 p. 100 du PIB. En 1993, l'armée de terre avait un effectif de 275 371 hommes, la Gendarmerie nationale de 91 263, la marine de 71 298 et l'armée de l'air de 95 822 auxquels il faut ajouter la section commune (79 072) et les effectifs d'outre-mer (19 740). En 1995, on recensait, toutes catégories de personnels confondues, 606 000 femmes et hommes (militaires et civils) relevant directement du ministère de la Défense, ce chiffre devant être réduit en l'an 2000. En 1996, la France a amorcé un rapprochement avec le commandement militaire unifié du Conseil de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord (Otan) qu'elle avait quitté en octobre 1966. La France a développé une force nucléaire autonome de dissuasion nationale comprenant entre autres des sous-marins nucléaires et des missiles balistiques. Au début des années 1990, il y avait encore des forces françaises stationnées en Allemagne et dans plusieurs pays d'Afrique, notamment au Tchad. En 1990, la France a pris part à la guerre du Golfe, envoyant des troupes et des navires de guerre dans le golfe Persique après l'invasion du Koweït par l'Irak. Elle a également envoyé des régiments de casques bleus en Bosnie à partir de 1993 et participé aux opérations militaires en ex-Yougoslavie dans le cadre de la Force d'intervention rapide créée avec la Grande-Bretagne et l'Otan, ainsi qu'aux opérations humanitaires au Rwanda à partir de 1994.
Economie La France, autrefois essentiellement agricole, s'est beaucoup industrialisée depuis la Seconde Guerre mondiale. Pendant la période de l'après-guerre, le gouvernement a lancé un ensemble de plans destinés à favoriser le redressement national, en conférant à l'État un rôle décisif dans le processus de modernisation de l'appareil productif. Partisan d'un modèle d'économie mixte et d'une forte intervention des pouvoirs publics dans la vie économique, le gouvernement du général de Gaulle procéda entre 1944 et 1946 à la nationalisation de plusieurs groupes industriels et de grandes banques, l'État devenant un acteur de premier plan dans l'industrie automobile, l'électronique et l'industrie aéronautique. Grâce à ces plans et à une conjoncture économique favorable, la France a pu combler une partie de son retard sur son principal concurrent (l'Allemagne), son produit national brut (PNB) s'accroissant de près de 50 p. 100 entre 1949 et 1954, de 46 p. 100 entre 1956 et 1964 et à un taux annuel moyen de 3,8 p. 100 pendant les années 1970. Avec les deux chocs pétroliers de 1973 et 1978, la croissance française, confrontée à l'inflation, s'est ralentie de manière importante, tandis que le chômage augmentait spectaculairement. En 1981, le gouvernement socialiste procéda à de nouvelles nationalisations mais dut rapidement infléchir sa politique économique après l'échec de sa politique de relance de la consommation en 1982-1983. La victoire des partis de droite aux élections législatives de 1986, suivie de la formation du gouvernement Chirac, aboutit à un désengagement progressif de l'État dans l'économie, visant à favoriser la libéralisation de l'économie dans un contexte nouveau de mondialisation des échanges. Ces orientations ne furent pas remises en cause, à partir de 1988, par les gouvernements Rocard (1988-1991), Cresson (1991-1992) et Bérégovoy (1992-1993), qui mirent l'accent, en liaison avec les nouveaux impératifs qu'implique pour la France la signature du traité de Maastricht, sur la lutte contre l'inflation et le maintien du franc fort, au prix d'une politique de rigueur et de réduction des déficits publics (en particulier des comptes sociaux), qui fut poursuivie par les gouvernements Balladur (1993-1995), Juppé (depuis 1995) et maintenant Josin .
Chiffres principaux Le produit intérieur brut de la France s'élevait à 7 675 milliards de francs en 1995, soit une croissance de 2,9 p. 100 depuis l'année 1994. Avec un PIB estimé à 131 999 francs par habitant, la France fait partie des pays très riches à l'échelle de la planète et se situe au quatrième rang des puissances économiques, après les États-Unis, le Japon et l'Allemagne.
En 1995, la France a connu une croissance de 2,4 p. 100 (2,9 p. 100 en 1994) et l'estimation avancée pour 1996 est de 1,3 p. 100. Par rapport à la récession de 1993, la France a bénéficié d'une amélioration substantielle de sa situation économique, qui s'est notamment traduite par un excédent de la balance commerciale et un solde positif de la balance des paiements courants. La raison de ce retour à la croissance tient au fait que la France a été stimulée par ses exportations et que la conjoncture économique est apparue plus favorable, notamment en raison de la reprise américaine, même si la tendance générale a manifesté ensuite des signes d'essoufflement, comme l'illustrent les problèmes économiques croissants de l'Allemagne. L'investissement, qui avait chuté de 30 p. 100 entre 1990 et 1993, a progressé de 6 p. 100 en 1995. D'une manière générale, la France souffre de deux maux, le chômage et le déficit budgétaire, qui hypothèquent lourdement les espoirs de réelle reprise : la lutte contre le chômage accroît le déficit budgétaire et la lutte contre le déficit budgétaire aggrave le chômage.
Les incertitudes sur l'avenir et la persistance d'un taux de chômage important ont pour conséquence d'inciter les Français à maintenir un niveau élevé d'épargne, qui empêche une reprise de la consommation, et fragilise les entreprises. Contrainte de respecter les critères de convergence définis par le traité de Maastricht en vue de l'accession à l'Union monétaire (moins de 3 p. 100 du PIB de déficit public, une dette publique inférieure à 60 p. 100 du PIB, un taux d'inflation au plus supérieur de 1,5 p. 100 à la moyenne de l'inflation des trois pays ayant le taux le plus faible, des taux d'intérêt moyens à long terme au plus supérieurs de 2 p. 100 à la moyenne des trois pays ayant l'inflation la plus faible, un taux de change qui reste compris dans la marge normale de fluctuation, prévue par le mécanisme de change du SME, soit 2,25 p. 100 par rapport au cours pivot), la France maintient une politique du franc fort et de rigueur salariale qui ne favorise ni la reprise de l'emploi, ni celle de la consommation.
Avec un budget de 1 558,2 milliards de francs en 1996 et un déficit budgétaire de l'ordre de 5,5 p. 100 du PIB, la France ne peut financer la lutte contre le chômage par une politique de grands travaux et peut difficilement réduire la pression fiscale. La charge de la dette, dont l'encours atteint 3 340 milliards de francs fin 1995, représente 226 milliards de francs en 1996, soit le deuxième budget civil de l'État. Si certains secteurs de l'économie affichent des résultats florissants, la tendance générale reste à la morosité.
Agriculture La France est un vieux pays agricole et reste une grande puissance mondiale dans ce secteur (1er producteur et exportateur de l'Union européenne). Environ 35 p. 100 de la superficie de la France est constituée par des terres arables (33 millions d'hectares cultivés contre 18 en Grande-Bretagne et en Italie) et 5,1 p. 100 des actifs travaillent dans l'agriculture (contre 26,6 p. 100 en 1954), contribuant pour 3 p. 100 à la formation du PNB français. Depuis les années 1960, de gros efforts de remembrement ont été entrepris afin de rationaliser l'activité. Les petites exploitations disparaissent progressivement et la taille moyenne s'accroît : elle est ainsi passée de 15,9 hectares par exploitation en 1963 à 28,1 en 1988. Si les exploitations de 10 à 30 hectares sont encore nombreuses, elles n'occupent plus que 8,5 p. 100 de la surface agricole utile (SAU), tandis que les exploitations de plus de 100 hectares détiennent à elles seules 23,7 p. 100 de la SAU. La motorisation, la sélection génétique, l'utilisation d'engrais et l'élevage hors sol ont également contribué à améliorer une productivité qui reste malgré tout moyenne face à certains pays concurrents.
Les recettes de l'agriculture se répartissent presque à égalité entre les cultures végétales (154 milliards de francs de recettes prévisionnelles pour 1995, soit 48 p. 100 du chiffre d'affaires agricole total) et l'élevage animal (143 milliards de francs, soit 48 p. 100 du chiffre d'affaires agricole total). Ces valeurs moyennes recouvrent des spécialisations régionales très affirmées, dans les cultures (plus de 90 p. 100 en Île-de-France) ou dans l'élevage (plus de 90 p. 100 dans le Limousin et en Bretagne). La politique agricole commune (PAC) de la Communauté économique européenne a contribué à soutenir les revenus des agriculteurs, mais a dû instaurer des quotas de production pour limiter les excédents (les quotas laitiers, par exemple). La crise de surproduction reste cependant un risque permanent et a donné lieu, en 1993, à de difficiles négociations au sein du Gatt (en raison notamment de la concurrence des États-Unis face à l'Europe pour les oléagineux et les céréales), au terme desquelles la France a finalement réussi à imposer un accord assez favorable au monde agricole.
Les principales productions animales sont les bovins (20,11 millions de têtes en 1994), production très affectée par la «crise de la vache folle» (encéphalopathie spongiforme bovine) qui a provoqué en 1996 une forte baisse de la consommation de viande bovine et a eu de graves conséquences sur la «filière bovine», les porcins (12,87 millions de têtes) et les volailles, qui situent la France au premier rang européen.
La France est le 5e producteur mondial de céréales avec une production de 53,2 millions de tonnes en 1994. Le blé représente une production de 29,94 millions de tonnes (5e rang mondial), le maïs 12,8 millions de tonnes (5e rang mondial), l'orge 8,02 millions de tonnes (6e rang mondial) et la pomme de terre 4,90 millions de tonnes (11e rang mondial). Les autres cultures sont le seigle et l'avoine, en net déclin, la betterave à sucre et le tabac. Les cultures fruitières ont une importance économique certaine dans les campagnes, notamment les poires, les prunes, les pêches, les abricots, les baies, les cerises, les olives, les citrons et les noix. La viticulture est également un secteur important de l'agriculture française : avec une production moyenne annuelle d'environ 7 milliards de litres, la France est le troisième producteur mondial de vin après l'Italie et les États-Unis.
En 1992, les exportations de produits agricoles atteignaient 36,2 milliards de dollars, faisant de la France le deuxième exportateur mondial de denrées agricoles après les États-Unis. La balance agricole française est toujours positive, l'excédent en 1993 a été de 7,67 milliards de dollars, soit 0,6 p. 100 du PNB. C'est la 7e balance agricole mondiale par son excédent.
Exploitation forestière et pêche Sur un total d'environ 14,7 millions d'hectares de forêts et de bois, deux tiers sont des propriétés privées. Près de 70 p. 100 des forêts sont constituées de chênes, de hêtres et de peupliers. La production de bois de coupe représentait environ 43 millions de mètres cubes en 1990, situant la France au 12e rang mondial, soit 0,78 m3 par habitant. La résine, l'essence de térébenthine et le liège sont également des productions importantes.
Près de 18 400 pêcheurs sont employés dans la flotte de 12 940 bateaux de pêche français qui pêchent dans les eaux côtières et en haute mer. En 1993, la pêche représentait 830 000 tonnes de prises, situant la France au 25e rang mondial (14 kg par habitant). Les récoltes de coquillages et de crustacés représentent 250 000 tonnes. Le colin, la morue, le merlan et le thon comptent parmi les prises les plus importantes.
Ressources minières La France dispose de ressources variées dans le domaine des minerais mais a longtemps souffert du manque de sources d'énergie classiques. Les réserves de minerai de fer sont parmi les plus riches du monde et la production annuelle représente 2,5 millions de tonnes en 1991. La production de bauxite était d'environ 500 000 tonnes en 1989. Ces deux ressources sont aujourd'hui en nette diminution, en raison d'une augmentation des coûts, qui a entraîné une croissance des importations, plus avantageuses. Concentrée dans l'est de la France, la production de charbon, en crise, n'atteignait plus que 8,57 millions de tonnes en 1993 contre 38 millions de tonnes en 1970. Le charbon produit en France revient à 300 francs la tonne environ, soit deux fois le cours mondial. En 1995, le secteur minier n'employait plus que 0,8 p. 100 de la population active, contribuant pour 1 p. 100 seulement à la formation du PNB.
Situé dans le Sud-Ouest, à Lacq, le principal gisement de gaz naturel sera épuisé d'ici la fin du siècle et la production baisse : elle n'était plus que de 3,36 milliards de m3 en 1994 contre 7 dix ans auparavant. Concentrée dans le sud-est du Bassin parisien, la production annuelle de pétrole, marginale, était de 3 368 000 tonnes en 1990. Mais les sociétés pétrolières françaises participent à l'étranger à une production de 49 millions de tonnes, principalement au Proche-Orient et Elf Aquitaine, l'une des principales entreprises du secteur au niveau mondial, est la première entreprise française en terme de chiffre d'affaires (20,7 milliards de francs en 1994). On extrait également en France des quantités significatives d'uranium (5e producteur mondial avec 2 119 tonnes extraites en 1994), de lignite, de pyrite, de potasse, de sel et de zinc.
Industries de fabrication Cinquième puissance manufacturière du monde, la France est la deuxième puissance industrielle européenne avec 17 p. 100 de l'emploi européen dans ce secteur et 21 p. 100 de la valeur ajoutée produite par l'industrie communautaire. Elle se situe au 6e rang mondial pour sa production, même si sa part relative diminue (5,5 p. 100 en 1980, 3,5 p. 100 en 1990). L'industrie occupe 20,7 p. 100 de la population active et contribue pour 28 p. 100 à la formation du PNB. Le premier secteur industriel est celui des machines et matériel de transport, qui réalise 30 p. 100 de la valeur ajoutée industrielle, suivi par l'agroalimentaire.
Les branches héritées de la première révolution industrielle ont mal résisté à la crise des années 1980-1990. La sidérurgie (14,7 millions de tonnes de fonte et 19,1 millions de tonnes d'acier en 1988) a traversé une grave crise de restructuration liée à une baisse de la demande mondiale. Le textile, victime de la concurrence des pays du Sud-Est asiatique, est également en crise mais il maintient son savoir-faire dans le coton et la fibre synthétique.
Parmi les industries produisant des biens de consommation durables (autres que la métallurgie), l'industrie automobile reste un grand pourvoyeur d'emplois, et se situe au 4e rang mondial ; la production de véhicules particuliers était de près de 3,9 millions par an à la fin des années 1980 et a été multipliée par onze depuis 1950. Les deux principaux producteurs d'automobiles en France sont Renault, groupe dont l'État ne possède plus que 46 p. 100 du capital, et Peugeot-Citroën. La France fait partie des leaders mondiaux pour certaines industries de pointe : l'armement, l'industrie spatiale et aéronautique, les techniques de communication, etc. L'industrie du bâtiment et des travaux publics compte plusieurs groupes industriels parmi les premiers du monde (Bouygues, Lyonnaise des Eaux, Dumez). L'industrie agroalimentaire est le premier secteur pour le chiffre d'affaires (640 milliards de francs en 1990) et rééquilibre, par ses exportations, une balance industrielle déficitaire dans d'autres domaines (informatique, hi-fi, électroménager). L'industrie française du luxe a une réputation internationale de qualité : les parfums, les champagnes et le vin, la haute couture et le prêt-à-porter, la porcelaine et la verrerie s'exportent dans le monde entier, confortant l'image d'un savoir-faire français particulier dans ce domaine.
Malgré des succès notoires, l'industrie française continue à souffrir d'un manque de compétitivité. Base 100 en 1985, l'indice de la production industrielle était à la valeur 113,4 en 1994. La Malaysia, à titre de comparaison, était à la valeur 246.
Energies Confrontés à la chute de la production charbonnière, à l'épuisement des gisements de gaz naturel et aux deux chocs pétroliers qui avaient brusquement fait monter le prix du baril, les gouvernements successifs ont progressivement substitué l'électricité aux autres sources d'énergie. Point fort du secteur énergétique français, l'électricité occupe le 7e rang mondial et le 2e rang pour la production d'origine nucléaire. Parallèlement, sa consommation ne cesse de croître : de 13,3 millions de TEP (tonnes équivalent pétrole) en 1973 (7,2 p. 100 de la demande d'énergie), elle est passée à 70,8 millions de TEP en 1989 (33,8 p. 100 de la demande d'énergie). L'électricité a permis au taux global d'indépendance énergétique de passer de 23 p. 100 en 1973 à 47 p. 100 en 1989. La production est aux trois quarts d'origine nucléaire (360 milliards de kWh en 1994), à 15 p. 100 d'origine hydraulique (72,3 milliards de kWh en 1994) et à 11 p. 100 d'origine thermique. Il existe aussi une petite production électrique d'origine marémotrice (0,6 milliard de kWh en 1994), provenant d'une centrale profitant des marées de la Manche sur l'estuaire de la Rance, près de Saint-Malo en Bretagne. En 1994, la France avait une production d'énergie primaire de 104,4 milliards de kWh et la production annuelle électrique avoisinait les 465 milliards de kWh.
Monnaies banques et institutions financières Accès à la partie sur l'Euro
Secteur tertiaire Comme dans les autres pays anciennement industrialisés, le secteur tertiaire est de loin le plus important en France. Il concentre 67,1 p. 100 de la population active et contribue pour 68 p. 100 à la formation du PNB, dont 17 p. 100 pour les services non marchands (administration) et 11 p. 100 pour le commerce. La distribution est caractérisée par la croissance du secteur des grandes surfaces, dont les pouvoirs publics tentent cependant de limiter une trop grande extension au détriment du petit commerce, le tourisme poursuit également son développement, rapportant à la France une quantité très importante de devises étrangères. La France est au deuxième rang mondial pour les sociétés de services et pour l'ingénierie informatique. Paris est la première place commerciale française, que ce soit pour le commerce intérieur ou extérieur, mais d'autres villes comme Marseille, Lyon, Lille, Bordeaux et Toulouse concentrent une part importante de l'activité commerciale.
Commerce extérieur La France est le quatrième pays au monde pour l'importance de son commerce extérieur, et le quatrième exportateur mondial. En 1994, l'excédent du commerce extérieur était d'environ 130 milliards de francs, témoignant du dynamisme des entreprises françaises à l'exportation et de l'augmentation de leurs parts de marché à l'étranger (5,9 p. 100 du marché mondial en 1980, 6,2 p. 100 en 1990). Pendant l'ensemble des années 1980, le pays a connu un déficit de son commerce extérieur, principalement à cause de ses achats de pétrole brut. Il n'était plus cependant que de 30,2 milliards de francs en 1991 contre 49,5 en 1990. Aux exportations, les biens d'équipement se placent en tête, suivis par l'agroalimentaire et les biens agricoles, les industries chimiques, l'automobile et le matériel de communication et de transport. Aux importations, on trouve les produits énergétiques, qui arrivent en tête devant les biens d'équipement, les produits chimiques et les biens agricoles. La France est le premier acheteur de produits industriels du monde, particulièrement de machines-outils. Le commerce avec la zone franc (Maghreb, Afrique noire) qui a représenté jusqu'à près de 30 p. 100 du commerce extérieur à l'époque de l'empire colonial, n'atteint plus que 12 p. 100 aujourd'hui. Plus de la moitié du commerce extérieur de la France se fait désormais avec l'Union européenne. L'Allemagne est le premier partenaire économique de la France et représente 18 p. 100 de ses échanges extérieurs, suivie par l' Italie (11,2 p. 100), le Benelux, le Royaume-Uni et les États-Unis. Les républiques de l'ex-URSS et le Japon sont aussi d'importants partenaires commerciaux. Dans le contexte actuel de mondialisation des échanges favorisé par un bond de 13 p. 100 du commerce international en 1994 (4 000 milliards de dollars) et l'accord du GATT d'avril 1994 qui a clôturé l'Uruguay Round, l'économie française s'ouvre de plus en plus sur l'extérieur et bénéficie de nombreux atouts dans le secteur des exportations.
Transports Le réseau de transports français compte parmi les plus développés d'Europe. Le réseau routier couvre 1,1 million de kilomètres, ce qui en fait l'un des plus denses du monde. Les autoroutes (7 000 km) concentraient 55 p. 100 du transport de marchandises en 1990, contre 40 p. 100 dans les années 1970. En 1990, il y avait près de 26 millions de véhicules en circulation, dont 22 millions de voitures particulières. Confrontées à la concurrence routière, les voies navigables (8 000 km) n'assurent plus que 5 p. 100 du transport de marchandises.
Les grands «ports autonomes» (Marseille, Le Havre, Dunkerque, Nantes-Saint-Nazaire) n'arrivent pas à faire face à la concurrence européenne et mondiale, et en 1989, ces quatre ports réunis avaient un trafic global de 209 millions de tonnes, soit moins que Rotterdam (premier port européen avec 290 millions de tonnes). La marine marchande française comprend environ 326 navires représentant une capacité totale de 5 920 tjb (tonne jauge brute ou capacité intérieure totale).
Les chemins de fer ont été nationalisés en 1938 avec la création de la SNCF, réunion de plusieurs réseaux nationaux. En 1990, il y avait environ 34 650 km de voies ferrées dont un tiers était électrifié. Le réseau ferroviaire est aujourd'hui en voie de restructuration, et on assiste à des fermetures de lignes secondaires et au développement des lignes à grande vitesse. Le train à grande vitesse (TGV) est une réussite technologique, que la France a exporté dans plusieurs pays. La première ligne, la ligne sud-est, reliant Paris à Lyon, a été inaugurée en 1981, suivie par la ligne ouest et sud-ouest en 1990. Le réseau TGV se développe depuis Paris (atteignant Lille en 1993, Londres en 1994, Amsterdam et Cologne via Bruxelles en 1996, et il est prévu qu'il desserve Turin et Strasbourg vers 2000). Le trafic marchandises décline (28 p. 100 du total national en 1988), alors que le trafic voyageurs se développe (1 000 km par an par habitant contre 700 en moyenne dans l'Union européenne). La France a une grande compagnie aérienne nationale, divisée en trois compagnies : Air France, qui assure les vols longue distance, Air Inter Europe, qui assure les vols intérieurs et dessert certaines destinations européennes, et l'Union des transports aériens (UTA), spécialisée dans le trafic avec l'Afrique. Avec la libéralisation du transport aérien, des compagnies privées sont apparues, dont les plus connues sont TAT, Air-Liberté et AOM. Ces compagnies offrent des vols sur des destinations nationales et internationales. Le trafic intérieur devrait également être dans un futur proche, ouvert aux compagnies étrangères. Les principaux aéroports français sont Charles de Gaulle (à Roissy) et Orly (45 millions de passagers en 1989), situés dans la banlieue parisienne.
Emplois Il y avait environ 24,6 millions d'actifs en 1991, dont environ 4 millions de chômeurs. La France est le 19e pays de l'OCDE sur 24 pour l'importance de son taux de chômage (12,6 p. 100 de demandeurs d'emploi en 1994). Moins de 20 p. 100 des travailleurs français sont membres d'un syndicat. La Confédération générale du travail (CGT) est la principale organisation syndicale (630 000 adhérents en 1994, mais elle a perdu au moins deux tiers de ses membres depuis 20 ans). Viennent ensuite la Confédération française démocratique du travail (CFDT) avec 520 000 adhérents en 1995, et la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) avec 370 000 membres en 1993. La Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) compte 100 000 membres et la Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC) 110 000. Les enseignants sont regroupés dans la Fédération de l'Éducation nationale (FEN) et dans la Fédération syndicale unitaire de l'enseignement, de l'éducation, de la recherche et de la culture (FSU), créée en 1993 par scission de la FEN. Le monde paysan est principalement représenté par la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles. Le salaire minimum, le Smic, est fixé par décret gouvernemental, mais les échelles de salaire de la fonction publique font l'objet de négociations régulières. Les syndicats participent à la gestion des organismes sociaux, selon le principe du paritarisme, en partie remis en cause par la réforme de la Sécurité sociale de 1995, et aux négociations contractuelles avec le patronat, le plus souvent sous l'égide de l'État.
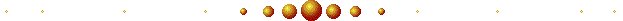 [Retour en haut de la page] ; [Retour à la carte de l'Europe] ; [Retour au sommaire]
[Retour en haut de la page] ; [Retour à la carte de l'Europe] ; [Retour au sommaire]