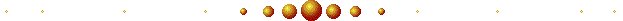Si vous n'entendez pas l'hymne du pays cliquez sur un des drapeaux ou sur le bouton actualiser de votre navigateur

|
|

|
Généralités
| Nom officiel | Royaume de Belgique (Koninkrijk België) |
| Continent | Europe (hémisphère nord) |
| Superficie | 31 000 km2 |
| Population | 10,2 millions d'habitants |
| Langue(s) officielle(s) | Français (wallon), néerlandais (flamand), allemand |
| Capitale | Bruxelles |
| Régime politique | Monarchie fédérale |
| Chef de l'Etat | Roi Albert II |
| Fête(s) nationale(s) | 21 juillet |
| Devise nationale | L'union fait la force |
| Monnaie nationale | Euro mais c'est le Franc belge (BEF=100 centimes) qui reste en circulation jusqu'en 2002 |
| PNB par habitant | 26 807 dollars par habitant |
| IDH [Indice de Développement Humain] (rang mondial) | 0,932 (13) |
| Budget de l'Etat | 52,2 % du PNB |
| Pays frontaliers | France, Luxembourg, Allemagne, Pays-Bas |
| Mers | Mer du Nord |
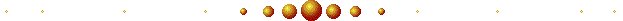
Géographie [Retour en haut de la page]
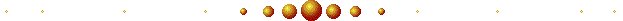
S'étendant entre les parallèles 49°30'N., à Torgny, et 51°30'N., à Meerle, le pays est situé entre les Pays-Bas au nord, l'Allemagne et le grand-duché de Luxembourg à l'est, la France au sud et à l'ouest, et le Royaume-Uni également à l'ouest mais de l'autre côté de la Manche. Il se trouve ainsi au centre de la plus importante région industrielle et urbaine de l'Europe occidentale (le quadrilatère Ruhr - Randstad Holland - Nord-Pas-de-Calais et Lorraine-Sarre), et au coeur de l'arrière-pays, desservi par la plus forte concentration de ports maritimes en Europe, du Havre à Hambourg.
Pays carrefour, la Belgique a toujours été un centre d'échanges économiques, culturels, sociaux et politiques, d'autant que son accessibilité générale fut améliorée au cours de l'histoire à la faveur de grands axes de communication le long desquels se développèrent de nombreuses villes marchandes ; celles-ci devinrent, au fil des siècles, de grands foyers expliquant la forte densité de population.
En outre, la Belgique se trouve au contact de deux mondes linguistiques (germanique et latin) et de deux mondes religieux (catholique et protestant).
Un plat pays se relevant au sud La grande plaine européenne, à laquelle se rattachent les deux tiers du pays, explique les faibles altitudes, toujours inférieures à 250 mètres jusqu'en bordure du sillon Sambre-Meuse. Cependant, les formes du relief sont variées.
Le littoral étroit est bordé d'un cordon de dunes sableuses qui atteignent jusqu'à 30 mètres à Kokzijde ; ce cordon très resserré s'élargit près de De Panne et de Knokke. A l'arrière s'étend une plaine maritime avec des altitudes de 0 à 5 mètres (parfois sous le niveau de la mer), qui pénètre davantage à l'intérieur des terres le long de l'Yser et surtout de l'Escaut.
Y succède vers l'intérieur, entre 5 et 50 mètres, la plaine de Flandre et de Campine, aux sols sableux et argileux, à la surface parfaitement plane le long des grandes rivières et aux élévations orientées selon une direction ouest-est;
Au-delà de la plaine, la surface du sol s'élève graduellement de 50 à 220 mètres vers le sud jusqu'au sillon Sambre-Meuse. Le relief est moins uniforme à cause de collines correspondant à des buttes témoins d'avant-plateau, dont les plus élevées atteignent environ 150 mètres (mont Kemmel : 156 m ; mont de l'Enclus : 141 m ; Pottelberg : 157 m). en bordure septentrionale du sillon, l'altitude est supérieure à 200 mètres (Hingeon : 220m et Anderlues : 212m). C'est une région de bas plateaux couverts de limon sous lequel se trouvent de l'argile à l'ouest, du sable et du grès dans le centre, et de la craie à l'est, en Hesbaye. Plus au nord, le plateau de Campine est plus limoneux ; il est fait de sable et de gravier;
Au sud des bas plateaux, la Sambre et la Meuse coulent dans un sillon large et profond, de direction ouest-est, développé dans des schistes tendres. Au-delà s'étendent d'autres plateaux : le Condroz (altitude maximale : 341m à Haversin) et l'Entre-Vesdre-et-Meuse (354m à Henri-Chapelle). Le relief du Condroz est ondulé, car il est fait de crêtes arrondies (les "tiges") qui correspondent à des grès plus résistants et de dépressions (les "chavées"), creusées dans des calcaires ; il est aussi traversé par des vallées profondes : la Meuse, de Dinant à Namur, le Hoyoux et l'ourthe inférieure. Le plateau de Condroz se prolonge au nord-est, au-delà de la vallée de la Vesdre, par le plateau de Herve, constitué de terrains argileux et fortement disséqué par des vallons descendant vers la basse Meuse et la Vesdre;
Au sud du Condroz, dans les schistes tendres, l'altitude descent à moins de 200 mètres : c'est la dépression Fagne (à l'ouest de la Meuse) - Famenne (à l'est). Puis elle s'élève jusqu'à 3000 mètres au nouveau de la Calestienne, une bande calcaire constituée de buttes arrondies (les "tiennes") dans lesquelles les cours d'eau ont creusé des grottes très importantes.
Ensuite le relief s'élève vers l'Ardenne, augmentant rapidement de 300 à 500 mètres jusqu'à un plateau morcelé par les profondes vallées de la Lesse, de la Lomme, de l'Ourthe et de l'Amblève. Composé de grès résistants et de schistes durs,le haut plateau ardennais présente des surfaces planes situées à des altitudes supérieures à 500 mètres : d'est en ouest, les Hautes Fagnes (avec le plateau de Losheim, 692m, le signal de Botrange, 694m, point culminant de la Belgique, la Baraque Michel, 657m), le plateau des Tailles (avec la Baraque de Fraiture (692m), le plateau de Saint-Hubert (289m), le plateau de Recogne-Bastogne (569m), la Croix Scaille (505m), puis à l'ouest de la Meuse, l'extrémité nord du plateau de Rocroi (389m). Ces parties du plateau ardennais sont isolées les unes des autres par des vallées aux méandres encaissés.
Quant à la bordure méridionale de l'Ardenne, elle surplombe la Lorraine dont le relief de côtes ne dépasse pas les 465 mètres. Le sous-sol est constitué de couches doucement inclinées vers le Sud et alternativement tendres et dures : les roches tendres (marnes et schistes) donnent des dépressions, où coulent la Semois, le Ton et la Vire ; les roches les plus dures (grès et calcaires) constituent des côtes dissymétriques (cuestas) dont le flanc abrupt est tourné vers le nord et le flanc en pente douce descend vers le Sud.
Une grande diversité géologique A l'exception de quelques roches éruptives en Brabant (comme le porphyre de Quesnast) et dans le Hainaut, le territoire belge est constitué de roches sédimentaires. De manière générale, les terrains primaires affleurent au sud du sillon Sambre-Meuse, sauf en Lorraine belge ; on les trouve aussi dans les vallées des bas plateaux du Brabant et du Hainaut. Les sédiments du secondaire recouvrent en discordance les terrains du primaire à la fois au nord (bassin de Mons, Hesbaye et Entre-Vesdre-et-Meuse) et au sud (Lorraine blege), tandis que les terrains tertiaires se retrouvent plus au nord, en Campine par exemple, ou plus à l'ouest, dans la dépression de la Haine. Quant au quaternaire, en dehors des sols de décomposition ou limoneux, il apparaît en Flandre maritime, de part et d'autre du bas Escaut et le long des cours d'eau du centre du pays
En fait, la Belgique a subi le contrecoup des plissements calédoniens, hercyninens et alpins, les deux premiers étant les plus perceptibles, surtout dans la moitié sud du pays, au Condroz et en Ardenne, deux régions qui ont été plissées en synclinaux et anticlinaux. de part et d'autre, des terrains plus récents et non plissés descendent en pente douce respectivement vers le nord et vers le sud.
Un climat tempéré et maritime Sa position en latitude et la proximité de la mer du Nord expliquent pourquoi la Belgique jouit d'un climat caractérisé par des températures modérées (9,8oC de température moyenne annuelle à Uccle, près de Bruxelles, siège de l'Institut royal météorologique) et des précipitations tout aussi raisonnables (800 mm par an).
Toutefois, malgré la taille réduite du pays, il existe des différences parfois sensibles entre les régions, voire localement. En fait, les variations de températures sont faibles en été, car les zones qui devraient être plus chaudes parce que plus éloignées de la mer (comme l'Ardenne) ont un relief marqué : 15oC en moyenne en juillet en Ardenne, contre 17oC à Bruxelles et 16oC sur le littoral. Par contre, en hiver, altitude et éloignement de la mer conjuguent leurs effets en Ardenne, expliquant une moyenne de 0oC en janvier, contre 3°C à Bruxelles et 3,5°C sur le littoral. On note aussi en Ardenne plus de 110 jours de gel par an, contre près de 60 à Bruxelles et 50 sur la côte ; de même les gelées y sont à la fois plus précoces et plus tardives. Quant à l'ensoleillement, il varie de plus de 1700 heures de soleil en moyenne par an sur la côte et en Lorraine, à moins de 1550 heures de parrt et d'autre du sillon Sambre-Meuse. Les précipitations varient également sur le territoire. La moyenne actuelle oscille entre 700 mm le long du littoral et 1400 mm sur le plateau des Hautes Fagnes.
En général, toute l'Ardenne est bien arrosée : il y pleut 200 jours par an, contre 160 à 180 dans le centre du pays. L'influence du relief est donc déterminante en raison d'une condensation accrue liée à l'ascendance forcée et à l'évaporation, proportionelle à la hauteur de la chute. Les brouillards, presque toujours associés à un anticyclone océanique, qui entraîne humidité et vent faible, varient aussi du nord au sud : quelque 30 jours en moyenne par an au nord de la Belgique, 40 au centre et de 50 à 70 au sud.
Quant au nombre moyen de jours de neige par an, il est également proportionnel à l'altitude. Toutefois, il s'agit souvent neige fondante, tombant sur un sol dont la température est supérieure à 0°C, ce qui limite fortement les périodes de pratique du ski et la rend même aléatoire en raison de fortes variations interannuelles.
Le temps est déterminé par le passage des cyclones atlantiques. Lorsque le centre d'un cyclone recouvre le pays, les vents du sud-ouest amènent toujours la pluie. Par contre, le glissement du cyclone vers l'est est synonyme de larges éclaircies. Par régime de haute pression barométrique, la Belgique bénéficie en été d'un ciel lumineux , de fortes chaleurs et de sécheresse. En hiver, un tel régime entraîne un froid très vif, avec gel et sous un ciel très clair.
Deux grands fleuves : l'Escaut et la Meuse La régularité des précipitations et la bonne perméabilité des sols favorisent le développement de cours d'eau bien alimentés, au régime régulier. Parmi eux deux grands fleuves, l'Escaut et la Meuse, drainent la quasi-totalité du territoire, alors qu'ils n'y ont ni leur source, ni leur embouchure.
Long de 430 kilomètres, l'Escaut prend sa source en France, sur le plateau de Cambrésis (à 150 m d'altitude) ; il entre en Belgique suivant une direction sud-nord jusqu'à la confluence avec la Lys. Il se dirige ensuite vers l'est jusqu'au sud d'Anvers, où il reçoit par la Nèthe, la Dyle et la Senne), puis prend la direction des Pays-Bas. L'Escaut est un fleuve de plaine presque sans pente. Son lit s'élargit de plus en plus vers l'aval (20 mètres à la frontière française 60 mètres à Gand et 400 mètres à Anvers) et se subdivise en deux bras au-delà de la frontière. Le bras oriental a été entièrement aménagé dans le cadre du plan Delta, nom donné aux travaux réalisés de 1958 à 1986 afin de lutter contre les inondations et qui consistèrent à relier par des digues les îles de la Hollande-Méridionale et de la Zélande. L'Escaut occidental, ou Hont, relie Anvers à la mer du Nord, malgré, l'apport constant d'alluvions par les courants de marée qui nécessite un dragage continuel.
La Meuse, d'une longueur de 950 kilomètres, naît en France sur le plateau de Langres (à 382 m d'altitude). Après la confluence avec la Semois, elle pénètre en Belgique et traverse le Condroz du sud au nord jusqu'à Namur, où elle reçoit la Sambre. Elle se dirige ensuite vers l'est jusqu'à Liège, où s'effectue sa confluence avec l'Ourthe et la Vesdre, puis prend la direction du nord jusqu'au centre des Pays-Bas. La Meuse sert de frontière avec le Limbourg néerlandais. A cause des principaux affluents de sa rive droite, qui viennent de l'Ardenne, la Meuse est soumise à des crues de printemps importantes. Pour éviter les inondations liées aux crues catastrophiques et faciliter la navigation en toute saison, le fleuve a été canalisé sur tourte sa longueur et plusieurs barrages avec écluses ont été construits.
La Belgique, dispose d'un troisième fleuve, l'Yser, long de 78 kilomètres, dont le bassin, presque entièrement côtier, est plus réduit que celui de l'Escaut ou de la Meuse. L'Yser vient aussi de France, mais il se jette dans la mer du Nord à Nieuport ; c'est donc le seul fleuve qui débouche dans la mer en Belgique.
En outre, certaines parties du territoire belge relèvent d'autres bassins hydrographiques : celui du Rhin, avec la Sûre et l'Our dans le sud-est du pays, et celui de la Seine, avec l'Oise qui prend sa source au sud de Chimay.
Cet important réseau de cours d'eau et l'existence de grandes nappes souterraines alimentent abondamment la Belgique en eau potable et en eau industrielle. Mais ces réserves sont surtout localisées en Wallonie, qui procure à Bruxelles et à la Flandre plus d'un tiers de sa production.
D'importants contrastes régionaux Malgré l'exiguïté du territoire, d'importants contrastes régionaux existent entre les principales régions agro-géographiques, présentées ici du nord au sud.
Le Littoral, d'abord, est un liseré côtier de faible altitude, composé d'une plage du côté du large et de dunes vers l'intérieur. La plus grande partie des dunes côtières est couverte de buildings et de villas, et la région constitue, de loin, la plus importante zone touristique du pays. La zone des polders, récupérés sur la mer et les estuaires, est à une altitude comprise entre 0 et 5 mètres. C'est une des régions les plus fertiles du pays, avec de gros villages et des fermes cossues disséminés dans une plaine quadrillée de canaux et de fossés, souvent jalonnés de saules têtards, d'hornes, d'aulnes ou de peupliers.
La plaine intérieure s'étend au sud des polders jusqu'en Campine, à l'est de l'Escaut. Très bien dépeinte par Jacques Brel (Plat pays), la plaine flamande, située entre 5 et 50 mètres, est très urbanisée. Elle se décompose elle-même en quatre sous-régions : la Flandre occidentale (West-Vlaanderen en néerlandais), assez fertile, la vallée flamande au nord de l'Escaut, aux sols les plus pauvres, le pays de Waes dans le coude de l'Escaut ansversois, au sol de qulité intermédiaire, enfin les plaines fluviales de l'Escaut, de la Lys et de la Durme, couvertes de prairies humides. La Campine, un plateau développé sur les graviers de la Meuse, prolonge la plaine intérieure vers l'est. Ses sols sablonneux sont en général plus pauvres et le climat devient plus continental. Dans l'ensemble, le paysage rural est fait de forêts, de landes, de terres de cultures et de prairies naturelles. Mais il comporte aussi marécages, plans d'eau, landes et pinèdes qui expliquent le succès touristique de la région.
Entre les plaines et les bas plateaux du centre du pays s'étire une zone sablo-limoneuse étroite, faite, comme nous l'avons déjà dit, de collines d'avant plateau. Leurs versants boisés voisinent avec des sommets couverts de terres de culture. On y distingue trois sous-ensembles : les collines flamandes, à l'ouest de la Dendre, les collines brabançonnes, entre le Dendre et la Dyle et le Démer. Les bas plateaux limoneux montent lentement de 50 à 220 mètres jusqu'au bord du sillon Sambre-Meuse. Ce sont les régions belges les plus fertiles grâce à leur couverture de limon. Le paysage y est largement, mais avec des variations sous-régionales : le Hainaut, le Brabant et la Hesbaye. Grandes cultures et prairies entourent les villages et les grosses fermes avec une cour intérieure.
Le plateau de Condroz s'étale au sud du sillon industriel Sambre-Meuse et voit son altitude s'élever progressivement de 200 à 350 mètres. Les limons abondent, mais en nappes discontinues. Le relief est très ondulé. Les zones de petits massifs de feuillus voisinent avec de riches terroirs agricoles, où l'on rencontre d'opulents domaines avec château et grosses fermes. Les vallées de la Meuse et de l'Ourthe y constituent de grandes zones touristiques.
Dans l'Entre-Vesdre-et-Meuse s'étale un plateau allongé : c'est le pays de Herve, région où dominent les herbages. Au sud du Condroz et avant l'Ardenne s'étend la longue dépression Fagne-Famenne. Malgré sa faible altitude (moins de 300 m), c'est une des régions agricoles les plus pauvres du pays, avec seulement des prairies et quelques forêts dans la partie nord. Au sud, les grottes foisonnent.
L'Ardenne évoque les hauts reliefs ; cette région de plus de 400 mètres d'altitude moyenne possède un climat plutôt rude et des sols souvent médiocres. Elle comporte plusieurs sous-régions : la haute Ardenne, ou Ardenne fagnarde, l'Ardenne septentrionale, l'Ardenne centrale, sillonné par la Lesse et la Semois, et l'Ardenne occidentale à l'ouest de la Meuse. Vaste étendue forestière où dominent les hêtres et les épicéas, l'Ardenne est constitué d'une alternance de plateaux et de vallées profondes. Les replats et les vallées abritent des clairières agricoles. Au nord-est existe une zone de landes et de tourbières.
Enfin, à l'extrême sud du pays, la Lorraine Belge est une région aux altitudes plutôt faibles et au climat souvent plus favorable qu'ailleurs en Belgique, notamment sur le versant méridional de la troisième côte (cuesta), où on cultive la vigne à Torgny.
Une nature très humanisée En Belgique, il ne reste presque rien de la végétation naturelle ; le contraire eût été étonnant dans un pays aussi densément occupé depuis des millénaires. Les immenses forêts qui recouvraient autrefois tout le territoire furent déboisées, le sol fut travaillé, drainé là où il était trop humide et irrigué là où il était trop sec.
Des associations végétales naturelles primitives, seules subsistent quelques bruyères et quelques lambeaux épars de la forêt originelle. Carex, roseaux et saules existent encore dans la région littorale et en Campine. Dans les pannes (dépressions) humides, la végétation est plus riche (saules, argousiers et sureaux) ; quant aux fonds, parfois inondés, ils abritent des plantes calcioles (gentianes et pyroles). Sur les hauts plateaux ardennais, le sol humide a favorisé une couverture de mousses (sphagnum), qui est à l'origine de la formation de tourbières ; celles-ci alternent avec une végétation plus sèche où dominent la lande et la bruyère quaternée Erica tetralix). Cette association végétale se rencontre également en Campine.
Des forêts entretenues ou plantées Actuellement 20% du territoire est couvert par la forêt : 55% en feuillus et le reste en conifères. Il s'agit surtout de forêts plantées ou entretenues ; elles se rencontrent en général sur les sols les plus pauvres principalement au sud du sillon Sambre-Meuse, en Ardenne notamment. Mais certaines forêts de feuillus - surtout de hêtres - se sont développées à la faveur de sols limoneux, telle la forêt de Soignes, près de Bruxelles.
A l'origine, c'est-à-dire à la fin des glaciations, à l'holocène, la forêt naturelle était une futaie claire et mélangée, avec prédominance du chêne et du hêtre, qui comportait aussi, selon les endroits, d'autres espèces comme le bouleau, l'orme, l'érable, le saule, le tremble, le tilleul, le coudrier, l'aulne, etc. On a pu identifier trois types d'association forestières primitives : un type à essence dominante de chêne au nord du sillon Sambre-Meuse, un deuxième type à essence principale de hêtre, au sud du sillon, et un troisième à essence dominante de bouleau, sur les sols arides et humides.
Si des traces de défrichement et de mise en culture sont nettes à partir du néolithique (2 500 ans av. J.-C.), les grands déboisements ne commencèrent qu'à partir de l'âge du fer (500 ans av. J.-C.) et s'intensifièrent lors de la période romaine. Après une pause due aux invasions et aux troubles, ils reprirent dès le XIIe siècle grâce au développement des abbayes. Ensuite, les forêts se dégradèrent à la suite des pratiques agro-pastorales et de l'essor des industries. Les terres riches furent ainsi quasi totalement déboisées, tandis que les forêts sur sols pauvres et celles des zones froides - objets de droits d'usage souvent importants - étaient maintenues.
Depuis la seconde moitié du XIXe, la superficie forestière belge a augmenté en raison de l'extension des peuplements résineux (l'épicéa en Ardenne et le pin sylvestre en Campine), qui ont permis de mettre en valeur des terrains impropres à la culture et de remplacer des bois peu productifs par des arbres à rendement plus élevé.
Des parcs naturels récents Les paysages naturels sont très rares en Belgique, exception faite des "shorres" (prés salés) le long du Zwin et de l'Escaut, des marécages le long des cours d'eau, de certaines dunes, des fagnes (marais tourbeux) de Campine et des étendues sèches surplombant des rochers. Il était donc impérieux de les conserver. En ce domaine, la Belgique enregistre un retard considérable sur les pays voisins. L'Etat ne créera les premières réserves naturelles qu'en 1957 : le Westhoek (dans les dunes littorales, près de la France) et la Fagne de Jalhay (dans les Hautes Fagnes).
Si le secteur public n'est intervenu que tardivement, les initiatives privées sont plus anciennes. Elles émanent principalement de deux associations : l'Association Ardenne et Gaume et les Réserves naturelles ou ornithologiques de Belgique, qui gèrent respectivement 3500 et 3000 hectares sur un total de 13 000 hectares pour l'ensemble des réserves naturelles du pays. L'Association Ardenne et Gaume s'occupe de plusieurs site remarquables du sud du pays, dont celui de Torgny, en Lorraine, où l'on avait découvert avant 1940, des espèces d'insectes inconnues. Les Réserves naturelles et ornithologiques de Belgique - issues d'une association créée en 1951 - administrent de nombreuses réserves qui regroupent la plupart des écopaysages belges, dont la célèbre réserve ornithologique du Zwin, dans les dunes littorales, près des Pays-Bas. D'autres associations de défense de la nature ont vu le jour, notamment De Wielewaal et Aves, qui ont aménagé des refuges ornithologiques, en Flandre et en Wallonie. Après 1970, année européenne de la conservation de la nature, sont apparues des initiatives plus ponctuelles : plantations d'arbres, curages de cours d'eau, etc.
Quant aux parcs naturels, ils n'existent légalement que depuis 1985. il s'agit de territoire d'au moins 5 000 hectares, où doivent coexister protection de la nature et développement économique. Le premier parc reconnu fut, en 1986, le parc Haute-Fagnes - Eifel (67 800 ha en Belgique et 176 000 ha en Allemagne) ; il avait vu le jour en 1971 à l'initiative de l'Association des amis de la Fagne, en collaboration avec la province de Liège. Un deuxième parc naturel a été reconnu en 1991 : celui de la Burdinale et de la Mehaigne, au nord-ouest de Huy (10 500 ha).
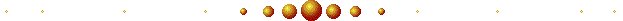
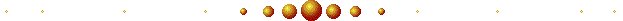
La politique économique de la Belgique est orientée vers l’Union européenne et l’obtention des critères de convergence du traité de Maastricht. Une des priorités est la réduction du déficit budgétaire ; le gouvernement a donc mis en place des mesures d’austérité visant à réduire les dépenses de l’État et souhaite réformer le système de protection sociale.
Les atouts de l’économie demeurent la réduction de l’inflation autour de 1,5 p. 100, la stabilité financière et la solidité de la monnaie ; cependant, la dette extérieure est encore très élevée puisqu’elle atteignait 140 p. 100 du PIB en 1995. L’autre préoccupation demeure le taux important du chômage qui atteignait 9,6 p. 100 de la population active en décembre 1995. En outre, les régions souffrent d’inégalités face au chômage puisqu’en Wallonie ce taux atteint 20 p. 100 tandis qu’en Flandre il est de 11 p. 100.
Agriculture, forêt, pêche Seulement 2,6 p. 100 de la population active est employée dans le secteur primaire qui ne représente plus que 2 p. 100 du PIB.
L’agriculture est intensive et productive, elle couvre près de 80 p. 100 des besoins alimentaires de la Belgique, mais la balance agricole demeure déficitaire. Environ 65 p. 100 des exploitations agricoles sont des unités de moins de 10 ha et pratiquent une polyculture intensive. Près de la moitié (45 p. 100) des surfaces arables sont consacrées aux cultures ou à l’élevage, et environ 3 p. 100 à l’horticulture.
Les principales productions sont le blé (27 p. 100 des terres), la betterave à sucre (13 p. 100), l’orge (9 p. 100) et la pomme de terre. Les fruits, les tomates et le lin comptent parmi les autres cultures d’importance. La production animale est prédominante : elle représente 68 p. 100 de la valeur ajoutée de l’agriculture. L’élevage, surtout bovin et porcin, et l’industrie laitière sont les secteurs les plus importants ; la Belgique assure environ 95 p. 100 de ses besoins en viande et est entièrement autosuffisante en produits laitiers. En 1995, le cheptel bovin comptait 3 350 000 têtes et le nombre de porcs atteignaient 6700 000.
Les forêts couvrent 20 p. 100 de la superficie du territoire ; elles sont situées dans le massif ardennais. Le produit des coupes représentait 4,5 millions de m3 en 1994, cependant la Belgique reste un pays importateur de bois.
Le principal port de pêche est Ostende. La flottille belge exploite des zones de pêche de l’Atlantique, depuis la mer du Nord jusqu’à l’Islande, mais est essentiellement côtière. Le total des prises en 1994 a été de 34 600 t.
Mines et industries Environ 28,4 p. 100 de la population active travaille dans le secteur secondaire, qui représente 30 p. 100 du PIB.
La Belgique est un pays d’industrialisation ancienne, qui a bâti son industrie sur la présence de gisements de houille, sur une situation géographique privilégiée et sur des infrastructures de transport très denses. La production industrielle, soutenue après la Seconde Guerre mondiale, a commencé à décroître dans les années 1960. La création de la Communauté économique européenne, en 1957, et la mise en oeuvre par le gouvernement de programmes d’aide à l’investissement entraînèrent un regain d’activité industrielle. Aujourd’hui, l’industrie est un secteur qui exporte.
Exploitations minières et énergies L’industrie sidérurgique occupe toujours une place importante, même si elle est en crise et si la production ne cesse de baisser. Historiquement, la houille est la principale ressource minérale de Belgique, mais les gisements faciles d’accès ont été en grande partie épuisés ou ne sont plus rentables, et la production a pratiquement été arrêtée à partir de 1984. En 1992, on a extrait des houillères 278 000 t de charbon ; la dernière mine ferma ses portes la même année. La crise des charbonnages et de la sidérurgie européenne a bouleversé l’équilibre des pôles économiques, la Flandre a supplanté une région wallonne enclavée à l’intérieur des terres, atteinte de plein fouet par le vieillissement de son économie. Toutes les mines des régions houillères de Wallonie situées aux environs de Mons, Charleroi, Liège et Namur ayant été fermées, le pays doit aujourd’hui importer de la houille. La Belgique est aussi un des plus gros importateurs de pétrole brut. Sa production de gaz atteignait 463,4 millions de m3 en 1993.
La seule énergie produite sur le sol national est d’origine nucléaire. En 1995, la production d’énergie électrique a été de 74,4 milliards de kWh, dont 41,4 p. 100 d’origine nucléaire.
Industries L’une des caractéristiques de l’industrie belge est la petite taille de ses entreprises qui deviennent alors vulnérables à toute tentative de concentration ou d’absorption. L’industrie textile belge a été restructurée. À l’exception du lin, toutes les matières premières sont importées. Les centres de l’industrie textile sont Bruges, Bruxelles, Gand, Liège, Courtrai et Malines. Elle produit tissus naturels, laines, cotonnades et tissus synthétiques, rayonne et acétate. Bruxelles et Bruges sont réputées pour leur industrie de la dentelle, du limon et du damas.
Les métaux non ferreux, en provenance de la République démocratique du Congo, alimentent les industries chimique et métallurgique. Celles-ci produisent essentiellement des machines, de l’acier et du matériel industriel.
Les autres secteurs industriels d’importance sont la construction navale à Anvers et la fabrication d’équipement ferroviaire, ainsi que les industries automobile, chimique et agroalimentaire. Anvers demeure l’un des plus gros fournisseurs mondiaux de diamants industriels taillés.
Tertiaire Le secteur des services occupe 69 p. 100 de la population active et représente 68 p. 100 du PIB.
Le secteur financier L’unité monétaire de la Belgique est le franc belge, divisé en cent centimes. L’institut d’émission de la monnaie est la Banque nationale de Belgique, fondée en 1850.
Les transports La circulation des biens a toujours été l’un des moteurs de l’économie belge. Les principales voies d’accès à la mer sont constituées par les estuaires de l’Escaut et de la Meuse, qui se trouvent aux Pays-Bas. Bien que située à plus de 80 km de la mer, Anvers, sur l’Escaut, est le deuxième port d’Europe et doit bénéficier de projets d’agrandissement. Les fleuves de Belgique sont reliés par un réseau très dense de canaux. La longueur totale des canaux et des cours d’eau navigable représente environ 1 600 km.
Outre les voies navigables, la Belgique possède 128 345 km de routes et 3 432 km de voies ferrées. Les chemins de fer appartiennent à l’État et non pas aux régions ; le réseau de chemin de fer belge est le plus dense du monde. Une ligne TGV devrait relier la capitale aux Pays-Bas. À partir de l’aéroport de Bruxelles, Sabena, la compagnie aérienne belge, exploite des lignes desservant les principales villes du monde.
Commerce extérieur Le commerce extérieur de la Belgique et celui du Luxembourg sont gérés conjointement depuis que les deux pays ont formé l’Union économique belgo-luxembourgeoise (UEBL) en 1921 ; jusqu’en 1990, un double régime des taux de change existait entre les deux pays et le franc belge a encore cours au Luxembourg. Une union douanière créée en 1948 entre la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas évolua pour devenir en 1958 un accord d’intégration économique totale, le Benelux. L’Union économique du Benelux, entrée en vigueur en 1960, a institué entre les trois États la libre circulation de la main-d’œuvre, des capitaux et des services.
Les principales importations belges concernent les matières premières transformables ou non, l’énergie, les produits finis et semi-finis (combustibles, minerais, machines et équipement électrique, produits alimentaires, etc.) et représentaient une valeur totale de 148 658 millions de dollars pour l’année 1995. Les exportations, composées essentiellement de produits sidérurgiques, de textiles, de produits chimiques, de machines et d’équipement de transport, de denrées alimentaires, de bétail et de diamants taillés, s’élevaient au total à près de 168 046 millions de dollars par an. L’Allemagne, la France, les Pays-Bas, la Grande-Bretagne et les États-Unis sont les principaux partenaires commerciaux de la Belgique.
En 1951, la Belgique devint membre de la Communauté européenne du charbon et de l’acier (CECA), et en 1957, elle adhéra à la fois à la Communauté économique européenne (aujourd’hui, Union européenne) et à la Communauté européenne de l’énergie atomique.