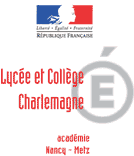Avertissement
Ces quelques lignes ne visent
qu’à initier le lecteur à la prise de vues
à l’aide d’un caméscope, à l’enregistrement
de fichiers AVI, et au traitement de ceux ci.
Les occasions ne manquent pas dans les programmes de sciences physiques.
Les techniques et les matériels
évoluant sans cesse, ce qui est dit ici, sera, et est sans doute
déjà, dépassé :
ainsi les webcams sont de plus de plus compétitives (prix en baisse
et performances en hausse) et devraient
remplacer les caméscopes dans les laboratoires de physique, cependant
certaines techniques sont communes
à ces différents types d’appareils.
http://www.ac-versailles.fr/pedagogi/physique-chimie/gep/webcam/index.htm
Il ne s’agit pas ici d’apprendre
à faire du cinéma : les séquences enregistrées
ne durent que quelques secondes
au maximum et ne servent qu’à l’étude des mouvements ou
des phénomènes en sciences physiques en classe avec des
élèves.
Peu ou pas de technique pointue :
le rédacteur en est bien incapable ! Certaines affirmations
de ma part sont
même à vérifier : elles sont signalées
par des points d’interrogation multiples.
- La prise de vue.
- Deux choses à ne pas confondre :
- La durée qui sépare 2 images successives.
- La durée d’ouverture de l’obturateur.
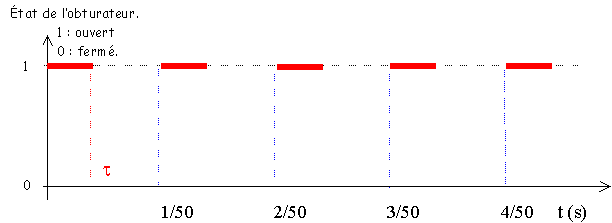
La fréquence de prise
de vues est de 50Hz : une image est prise tous les 1/50ème
de seconde mais pendant
la durée t seulement (t
< 1/50s). Ce n’est que pendant cette durée t
que l’image est saisie.
La vitesse d’obturation est définie par t
(1/50,
1/100, 1/250, …, 1/2000 etc.).
La vitesse d’obturation est donc une durée et non une vitesse.
Expérience
possible :
relier le caméscope à un téléviseur et filmer
un petit moteur tournant à 50 Hz.
On observera l’immobilité apparente.
- Choix de la vitesse d’obturation (shutter).
- Éclairage.
- Mise au point.
- Pied.
- Supports d’enregistrement.
Tout dépend de
ce qu’on veut filmer : une scène de la vie courante peut
être filmée au 1/50ème
de seconde sans problème car le mouvement est assez lent et
qu’on ne s’intéresse pas aux images
prises isolément.
En physique on veut saisir
le mouvement d’un objet qui se déplace c’est à
dire qu’on souhaite connaître
les positions de cet objet en fonction du temps. Si pendant t
l’objet s’est déplacé on ne le verra pas
dans une seule position. Par exemple un mobile (ponctuel) qui se déplace
à 10 m.s-1 parcourt 20 cm
pendant 1/50 s : on verra un trait de 20 cm. Si on choisit t
= 1/2000 s le déplacement ne sera que
de 5 mm et la position du mobile est donc mieux définie.
http://www.ac-nancy-metz.fr/enseign/physique/video/meca/meca02.htm
(la vidéo est assez longue à charger avec un modem mais pas plus de 2 min maxi).
Pour qu’il rentre suffisamment
de lumière dans le caméscope, l’ouverture du diaphragme
doit être augmentée
quand on utilise des vitesses rapides. Le réglage de cette
ouverture est fait automatiquement par le
caméscope ou on peut le faire manuellement. Dans les 2 cas
il est souvent impératif d’éclairer la scène
à filmer ou de travailler en extérieur sinon l’image
sera trop sombre pour être correctement exploitée.
C’est le réglage
de la distance pour que l’image soit nette. On peut laisser faire
l’autofocus de l’appareil
mais souvent il est préférable de faire la mise au point
manuellement surtout si les scènes filmées sont proches.
Cette mise au point doit être
soignée car à grande ouverture la profondeur de champ
est très faible.
La faible distance augmente encore la difficulté. On peut alors
filmer d’assez loin et utiliser le zoom (optique).
Conseil :
faire la mise au point manuellement sur un petit détail saisi
avec le zoom en position
téléobjectif (T) puis élargir avec le grand angle
(W) à la taille voulue.
Cet accessoire est pratiquement
obligatoire pour filmer les mouvements car le caméscope doit
être
immobile (il doit être lié au référentiel
d’étude).
- Le plus souple d’utilisation est la cassette
du caméscope mais l’étude directe des images saisies
est pratiquement
impossible. Par exemple la fonction image par image n’est pas toujours de bonne qualité. Mais si on veut filmer
en extérieur ou sans fil " à la patte " c’est le support idéal.
- La cassette d’un magnétoscope
(3 têtes) est un autre choix : le caméscope est utilisé
en caméra et le magnétoscope enregistre sur sa propre
cassette VHS. L’étude image par image sur un écran de
téléviseur est possible et
surtout on peut " oublier " le caméscope qui filme en permanence.
- Le disque dur d’un ordinateur. Pourquoi
pas ! Mais il est très difficile d’être partout à
la fois : près du dispositif expérimental, et près
de l’ordinateur. De plus les fichiers vidéo sont énormes
et la centaine de Mo est très
vite atteinte. Souvent 1 à 2 secondes seulement d’un enregistrement ont un intérêt et il est préférable
de ne stocker que ces quelques images (fichiers de l’ordre de quelques centaines de ko). Je conseille donc,
pour commencer, de filmer et d’enregistrer sur bande magnétique (caméscope ou magnétoscope) puis de passer sur l’ordinateur : on y perd certainement en qualité mais on y gagne beaucoup en souplesse d’utilisation.
Avec l’expérience cet intermédiaire magnétique pourra être supprimé.
- Utilisation des images avec un magnétoscope.
- Principe.
- Mise en œuvre.
- L’enregistrement sur disque dur.
- L’ordinateur.
- La carte vidéo.
- Enregistrement.
- Conversion et découpage.
On utilise la fonction
image par image du magnétoscope.
Celui-ci doit posséder 3
têtes pour assurer une bonne qualité de l’arrêt
sur image.
La séquence est projetée
sur un téléviseur sur l’écran duquel a été
fixé (ça tient tout seul !) un papier calque
ou transparent. On note la position du mobile sur cette feuille pour
chaque image c’est-à-dire tous les 1/25 s.
La projection peut aussi être
faite sur un écran à l’aide d’un vidéo projecteur.
Remarque :
la 4ème tête d’un magnétoscope ne
sert qu’à augmenter la durée d’enregistrement en
autorisant une vitesse plus lente pour le défilement de la
bande.
Méthode qui permet l’étude des images vidéo sans l’ordinateur.
Utilisable en classe entière
pour une expérience de cours (qualitatif) ou bien en TP avec
un petit nombre
d’élèves qui doivent se déplacer pour faire leur
enregistrement sur l’écran.
Expérience
à réaliser :
filmer un chronomètre à aiguille quelques secondes (ancien
chronomètre qu’on
trouve dans les lycées) et vérifier avec cette méthode
(magnétoscope + TV) qu’entre 2 images
il s’écoule bien 40 ms. (On ne visualise que les trames paires
ou impaires ? ? ?). Les autres
chronomètres (à affichage) ne donnent pas de bonnes observations.
Il doit être " sérieux " !
Windows 98 est souhaitable (la carte DC 10 ne fonctionne pas
sous Windows 95), un processeur de fréquence supérieure
à 500 MHz, beaucoup de mémoire vive
(RAM – 64 Mo minimum) et un gros et rapide disque dur ( 20 Go au moins).
C’est le standard actuel (2002).
Mais surtout il doit posséder
une carte d’acquisition des images vidéos.
2 types de cartes : analogique ou numérique.
Pour l’acquisition des
images (en sciences physiques) une carte analogique est suffisante.
Type souvent cité :
Miro DC 10+ (maintenant Studio DC10), mais nous travaillons
(au Lycée Charlemagne) avec une autre carte
(ATI all in wonder qui ne se fait plus …). Le principe d’acquisition
étant identique.
De plus, dans le cas d’une
carte numérique, il faut un caméscope du même
type et il faudrait détramer
les images : sur une même image on a les 2 trames, donc
2 positions du même mobile à 2 instants
séparés de 1/50 s).
Pour la carte analogique, les images sont séparées de 40 ms (25 images par seconde).
http://www.ac-grenoble.fr/isle/videonum.htm
Relier le caméscope
à l’ordinateur et ouvrir le logiciel d’acquisition (celui de
la carte ou bien Vidcap
de chez Bill). Utiliser le caméscope en lecteur de bande vidéo
qui contient la scène filmer ou le caméscope
utilisé en caméra filmant la scène en direct.
Transférer sur
le disque dur la scène filmée sans chercher à
commencer juste au début et à s’arrêter
juste à la fin (l’enregistrement ne démarre pas ni ne
s’arrête exactement à la demande).
Mais là commencent les ennuis !
Le fichier enregistré
(format .AVI) ne sera lisible que par l’ordinateur qui a fait l’acquisition
car lui seul
possède les CODEC (de Compression et DECompression) qui ont
servis à générer ce fichier. Ces CODEC
sont liés à la carte d’acquisition.
Autrement
dit, tous les fichiers AVI ne sont pas lisibles sur n’importe quel
ordinateur. C’est gênant pour
faire travailler les élèves sur des postes standard
(sans la carte) !
IL faut donc convertir le fichier AVI particulier en fichier AVI standard.
http://www.ati.com/support/fr/infobase/2396.html
Expérience possible : essayer de lire un fichier AVI particulier sur un ordinateur sans la carte.
Un logiciel incontournable et gratuit ! Virtualdub. Il fait tout, même l’acquisition.
http://virtualdub.sourceforge.net/
http://www.geocities.com/virtualdub/
On peut aussi utiliser Videdit
(de chez Bill) ou bien le logiciel d’édition vidéo livrée
avec la carte (logiciel de montage).
Ce type de logiciel permet de découper
la séquence à notre guise en n’enregistrant que les quelques
dizaines
d’images souhaitées.
Il permet aussi de convertir ce fichier
AVI particulier en fichier standard.
3 CODEC sont courants sur tous les PC (à vérifier sur chaque ordinateur):
- Cinepak
- Indeo R3.2
- Vidéo 1 (Microsoft)
Dans le " Panneau de configuration " d’un ordinateur standard dépourvu de carte d’acquisition on peut lire :
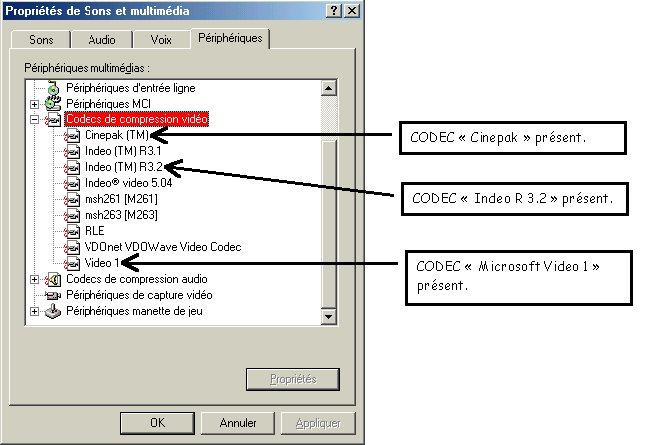
Au moment d’enregistrer le fichier AVI il faudra donc veiller à utiliser l’un des ces 3 CODEC (Cinepak par exemple).
Expérience
obligatoire !
Enregistrer un petit fichier AVI standard et vérifier qu’il est
lisible par
n’importe quel PC.
Conseil : éviter les images trop grandes (320x240 est un bon compromis).
- Exploitation des fichiers vidéos.
- Logiciels de pointage.
- Exploitation.
Il en existe plusieurs
dont certains téléchargeables sur les différents
sites académiques :
Aviméca2 et REGAVI de chez Micrelec.
Sans oublier MARQUEUR de notre collègue de Nancy (Pierrette MAX).
http://www.ac-nancy-metz.fr/enseign/physique/logiciels/Marqueur/Marqueur.zip
http://www.ac-rennes.fr/pedagogie/scphys/outinfo/log/avimeca/avimeca2.zip
http://perso.wanadoo.fr/jean-michel.millet/regavi.zip
Les logiciels de pointage
permettent d’obtenir les fichiers exploitables par REGRESSI ou par EXCEL
(on obtient les triplets t , x et y pour chaque point du mobile en mouvement).
Ce qui peut être fait :
- Étude cinématique des mouvements.
- Etude dynamique.
- Etude énergétique.
- Changement de référentiel, mouvements relatifs.
- Et bien d’autres choses.
En conclusion,
il faut considérer ce document comme une initiation. Je n’ai aucune
prétention,
je souhaite simplement décider ceux qui n’osent pas encore franchir
le pas.
Les explications techniques sont réduites au minimum : on les trouvera sur les sites indiqués.
Philippe.Girondeau@ac-nancy-metz.fr